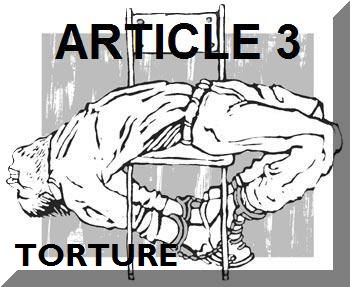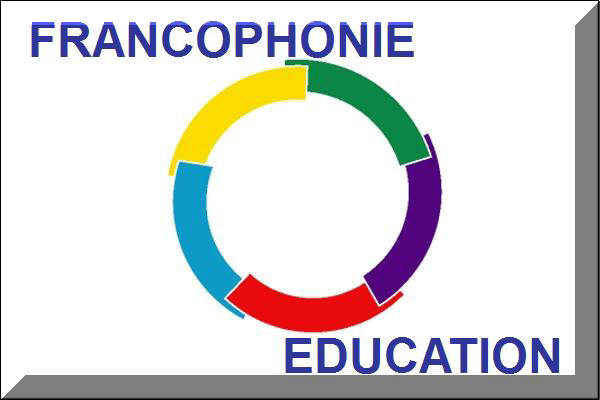PAS DE CRIME, PAS DE PEINE, SANS LOIARTICLE 7 DE LA CONVENTION
ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
nullum crimen, nulla poena sine lege
 ARTICLE
7 DE LA CONVENTION
ARTICLE
7 DE LA CONVENTION
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées"
L'ARTICLE 7 NE PEUT ÊTRE INVOQUE QUE PAR LES INDIVIDUS CONDAMNES
Arrêt Grande Chambre Michaud C. France du 6 décembre 2012, Requête 12323/11
133. Le requérant se plaint du fait que le règlement professionnel du 12 juillet 2007 ne définit pas suffisamment les obligations mises à la charge des avocats sous peine de sanctions disciplinaires, dès lors qu’il renvoie à des notions générales et vagues telles que « déclaration de soupçon » et devoir de « vigilance ». Voyant là une méconnaissance du principe de sécurité juridique, il dénonce une violation de l’article 7 de la Convention.
La Cour rappelle que l’article 7 prohibe l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé, et consacre, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé, dont il résulte qu’ « une infraction doit être clairement définie par la loi » (Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série § 52, A no 260-A). Il ne s’applique que dans le contexte de procédures « pénales », au sens de la Convention, ayant abouti à une « condamnation » ou au prononcé d’une « peine ». Or, à supposer que l’instance disciplinaire à laquelle peut conduire le non-respect du règlement professionnel du 12 juillet 2007 puisse être qualifiée de « pénale » au sens de la Convention, la Cour constate que le requérant n’a pas fait l’objet d’une telle procédure. Ainsi, en tout état de cause, il ne peut se dire victime de la violation de l’article 7 qu’il dénonce. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.
134. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’obligation faite aux avocats de déclarer leurs « soupçons » relatifs à des activités illicites éventuelles de clients est incompatible avec le droit de ces derniers de ne pas s’auto-dénoncer et avec la présomption d’innocence dont ils doivent pouvoir bénéficier.
La Cour constate que le requérant dénonce ainsi une violation des droits d’autrui. Il ne peut donc prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.
LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- La loi pénale doit être prévisible, accessible, prescriptible et conforme à la Convention.
- La loi pénale ne peut pas être rétroactive
- La loi sur les crimes de guerre et contre l'humanité, peut être rétroactive
- La jurisprudence contre les Etats francophones.
LA LOI PENALE DOIT ETRE PREVISIBLE, ACCESSIBLE
PRESCRIPTIBLE ET CONFORME A LA CONVENTION
ArrêtCoeme et autres contre Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96; 33210/96
![]() LA COUR EXIGE QUE LA
LOI PENALE SOIT PREVISIBLE
LA COUR EXIGE QUE LA
LOI PENALE SOIT PREVISIBLE
"L'article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie. Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment"
![]() LA COUR EXIGE QUE LA
LOI PENALE SOIT ACCESSIBLE
LA COUR EXIGE QUE LA
LOI PENALE SOIT ACCESSIBLE
"Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin de l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux , quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale"
![]() LA COUR ELARGIT SA
PROPRE COMPETENCE AUX BUTS ET PRINCIPES GENERAUX DE LA
CONVENTION
LA COUR ELARGIT SA
PROPRE COMPETENCE AUX BUTS ET PRINCIPES GENERAUX DE LA
CONVENTION
"La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition.
La notion de "peine" possédait une portée autonome, la Cour doit, pour rendre efficace la protection offerte par l'article 7, demeurer libre d'aller au delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure particulière s'analyse au fond en une "peine" au sens de cette clause (Welsch contre Royaume-Uni du 09/02/1995)
Si le texte de la Commission est le point de départ de cette appréciation, la Cour peut être amenée à se fonder sur d'autres éléments dont les travaux préparatoires. Eu égard au but de la Convention qui est d'un équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux de l'individu ainsi que les conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques"
![]() LA CEDH PROTEGE LE
PRINCIPE DU DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE
PENALE
LA CEDH PROTEGE LE
PRINCIPE DU DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE
PENALE
"Le délai de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé"
LA PREVISIBILITE DE LA LOI PENALE
Arrêt K.A et A.D contre Belgique du 17/02/2005; requête 42758/98 et 45558/99
Les poursuites pour coups et blessures concernent toutes les situations, même les pratiques sexuelles "librement consenties":
51. La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence, l’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et, partant, celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive en défaveur de l’accusé. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Veeber c. Estonie (no 2), no 45771/99, § 31, 21 janvier 2003).
52. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais d’examiner sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elles ont été commises, les actions des requérants constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 51, CEDH 2001-II). Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe toutefois immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. S’il revient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 541, § 59), la Cour se doit de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation qui serait faite. La tâche qui lui incombe est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable (Murphy c. Royaume-Uni, requête no 4681/70, décision de la Commission des 3 et 4 octobre 1972, Décisions et rapports 43, p. 1, et Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, Recueil 2000-VII, § 145).
53. La Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 juin 1996, Recueil 1996-V, § 35). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, notamment, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p 71, § 37, et Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2587, § 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques que comporte une action ou omission (Cantoni, précité, § 35).
54. La Cour constate d’emblée que le texte même des dispositions litigieuses n’est pas mis en cause en l’espèce. L’argumentation des requérants vise essentiellement l’existence d’une tolérance qui se serait développée dans une « société permissive, libérale et individualiste », où des formes d’expérience sexuelle collective seraient tolérées et où le citoyen moyen ne serait plus choqué par nombre de pratiques. Cette tolérance serait, de l’avis des requérants, de nature à les induire à considérer que leurs pratiques ne seraient plus susceptibles de leur être pénalement reprochées sur base des articles 380bis et 398 du code pénal.
55. De l’avis de la Cour, on ne saurait attacher, comme le font les requérants, une importance déterminante à l’absence de précédents jurisprudentiels comparables, s’agissant des coups et blessures. Les pratiques en question étaient tellement violentes - et donc sans doute tellement rares - que l’absence de jurisprudence pertinente ne saurait guère étonner. L’absence de précédents ne pouvait être une circonstance empêchant les autorités nationales d’intervenir. Dans le cas contraire, on aboutirait à ce paradoxe que plus une pratique (sadomasochiste ou autre) est violente et donc rare, quelles que soient ses conséquences, plus elle a des chances d’échapper à l’application de la loi pénale. Les requérants ne pouvaient pas non plus penser que le consentement de la victime pouvait constituer une cause de justification susceptible de « neutraliser » l’élément légal de celle-ci et, partant, affecter son existence, puisque le consentement de la victime de l’infraction ne constitue pas une cause de justification proprement dite. Le premier requérant, magistrat, ne pouvait ignorer ce principe bien établi que la cour d’appel d’Anvers a réaffirmé dans son arrêt du 30 septembre 1997 et auquel la Cour de cassation s’est référée, dans son arrêt du 6 janvier 1998, en décidant que « le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal de ces faits, ni la culpabilité de l’auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification ».
56. Il est vrai que la jurisprudence estime qu’il existe des cas spécifiques d’autorisation - explicite ou implicite - par la loi d’actions ou de comportements pouvant être qualifiés de coups et blessures. Si l’on peut déduire des décisions rendues en l’espèce par la cour d’appel et la Cour de cassation que la loi ne sanctionne pas toute pratique sadomasochiste, de telles pratiques ne pouvaient toutefois être justifiées en droit interne que dans les limites de l’autorisation de la loi, c’est-à-dire dans le respect des règles applicables dans ce domaine. Tel n’est pas le cas en l’espèce et les requérants, en particulier le premier comme magistrat, se devaient de le savoir.
57. A cet égard, aux yeux de la Cour, deux éléments doivent être pris en considération dans le cas d’espèce. D’une part, il apparaît que les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées par les requérants : non seulement de grandes quantités d’alcool ont été consommées lors de ces séances, ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation, mais en outre ils auraient également ignoré que la victime criait « pitié » et « stop », mots par lesquels il aurait été convenu entre les intéressés que ceux-ci devaient mettre fin aux opérations. D’autre part, les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques sadomasochistes.
58. La Cour en déduit que les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. Elle rappelle, en outre, que les requérants sont respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.
59. Un même raisonnement doit, à plus forte raison, s’appliquer s’agissant de l’application de l’article 380bis du code pénal, car à l’époque il y avait déjà de la jurisprudence et de la doctrine qualifiant certaines pratiques sadomasochistes de débauche.
60. La Cour constate, enfin, que les requérants ont eu la possibilité de présenter leurs objections concernant l’application des dispositions litigieuses à leur encontre devant deux instances successives et que celles-ci les ont prises en considération. Eu égard à leurs décisions amplement motivées sur ce point, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables.
61. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.
Arrêt Soros C. France requête 50425/06 du 6 octobre 2011
Georges Soros allègue une violation de l’article 7 de la Convention en raison de l’imprécision des textes ayant servi de fondement à sa condamnation pénale.
Sur le grief tiré de l’imprévisibilité de la loi au moment des faits
50. La Cour renvoie principalement aux affaires C.R. c. Royaume-Uni (22 novembre 1995, §§ 35 à 44, série A no 335-C), S.W. c. Royaume-Uni, (22 novembre 1995, §§ 37 à 47, série A no 335-B), Cantoni c. France (15 novembre 1996, §§ 29 à 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), Achour c. France ([GC], no 67335/01, § 42, CEDH 2006-IV) et K.-H.W. c. Allemagne ([GC], no 37201/97, §§ 44 et 45, CEDH 2001-II).
51. Elle a déjà constaté qu’en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L’une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d’autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 40, série A no 260-A).
52. L’utilisation de la technique législative des catégories laisse souvent des zones d’ombre aux frontières de la définition. A eux seuls, ces doutes à propos de cas limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible avec l’article 7, pour autant que celle-ci se révèle suffisamment claire dans la grande majorité des cas. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (voir, mutatis mutandis, Cantoni, précité, § 32).
53. La Cour rappelle enfin que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir, mutatis mutandis, Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173). La prévisibilité́ de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 37, série A no 316-B). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte.
b) Application au cas d’espèce
54. La Cour est appelée à rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale litigieuse, lu à la lumière de la jurisprudence interprétative dont il s’accompagne, pouvait, à l’époque des faits, passer pour prévisible. Elle observe que comme beaucoup de définitions légales, celle du terme « initié » contenue dans l’ordonnance du 28 septembre 1967 est assez générale et qu’en l’espèce les parties sont en désaccord sur la portée de l’expression « à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions » contenue dans cette ordonnance.
55. La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a soulevé le grief tiré de l’insuffisante prévisibilité de la loi réprimant le délit d’initié devant toutes les juridictions appelées à le juger. Or, chacune d’entre elles a estimé que la loi applicable était suffisamment précise pour lui permettre de savoir qu’il ne devait pas investir dans des titres de la banque S. après avoir été contacté par P.
56. La Cour prend acte des jurisprudences citées par le Gouvernement et antérieures à la commission des faits. Celles-ci concernent notamment un journaliste financier, professionnellement chargé de suivre la marche technique, commerciale et financière de plusieurs entreprises et d’en rencontrer les dirigeants qui fut condamné pour avoir utilisé plusieurs informations privilégiées acquises au cours d’entretiens avec ces dirigeants (tribunal correctionnel de Paris, 12 mai 1976). Il s’agit également d’un attaché de direction, d’un conseiller technique et du directeur d’une société d’architecture qui, à l’occasion de leurs fonctions, ont eu connaissance du rapprochement de deux sociétés et exploité cette information (tribunal correctionnel de Paris, 15 octobre 1976) ou d’un administrateur de plusieurs sociétés qui avait appris, au cours d’une séance du conseil d’administration de l’une d’entre elles, que le montant des bénéfices permettait d’envisager une hausse du cours de l’action et qui a fait fructifier cette information avant qu’elle ne soit rendue publique (tribunal correctionnel de Paris, 19 octobre 1976).
57. Elle observe avec le requérant que ces affaires ne concernent pas des situations analogues à la sienne puisque les personnes auxquelles elles se rapportent avaient toutes un lien professionnel avec la société convoitée. Toutefois, de l’avis de la Cour, ces jurisprudences, même si elles émanent de juridictions de première instance, ont trait à des situations suffisamment proches de celle du requérant pour lui permettre de savoir, ou à tout le moins de se douter, que son comportement était répréhensible. En effet, s’il était interdit aux professionnels qui, de par l’exercice de leurs fonctions, avaient connaissance d’une information privilégiée, d’intervenir sur le marché boursier, une interprétation raisonnable de cette jurisprudence permettait de penser que le requérant pouvait être concerné par cette interdiction, qu’il soit ou non lié contractuellement à la banque S.
58. Au demeurant, s’il est avéré que le requérant a été le premier justiciable à être poursuivi en France pour délit d’initié, sans être lié ni professionnellement ni contractuellement à la société dont il a acquis les titres, la Cour estime qu’on ne saurait pour autant reprocher en l’espèce un manquement de l’Etat pour ce qui est de la prévisibilité de la loi car faute de situation strictement identique soumise précédemment aux juges, les juridictions nationales n’avaient pas jusqu’alors été mises en mesure de préciser la jurisprudence sur ce point. En tout état de cause, même si aucune affaire n’avait été examinée en appel ou en cassation, des juridictions de première instance s’étaient prononcées sur des situations connexes (voir paragraphe 56 ci-dessus). La Cour observe que depuis les faits de la présente espèce, cette jurisprudence s’est progressivement développée en fonction des affaires soumises aux juridictions internes.
59. Surtout, et quel que soit le niveau de développement de la jurisprudence interne à l’époque des faits, la Cour note que le requérant était un « investisseur institutionnel », familier du monde des affaires et habitué à être contacté pour participer à des projets financiers de grande envergure. Compte tenu de son statut et de son expérience, il ne pouvait ignorer que sa décision d’investir dans les titres de la banque S. pouvait le faire tomber sous le coup du délit d’initié prévu par l’article 10-1 précité. Ainsi, sachant qu’il n’existait aucun précédent comparable, il aurait dû faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’il a décidé d’investir sur les titres de la banque S.
60. Enfin, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel son comportement serait à l’origine d’une modification de la législation applicable. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre sa situation personnelle et l’élaboration d’un rapport sur la déontologie boursière à la demande du ministre des Finances de l’époque ainsi que les modifications de la loi qui s’ensuivirent.
61. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la loi applicable à l’époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre au requérant de se douter que sa responsabilité pénale était susceptible d’être engagée du fait des opérations financières réalisées auprès de la banque S.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.
LA LOI PENALE NE PEUT ÊTRE RETROACTIVE
Arrêt Welch contre Royaume Uni du 09 février 1995 Hudoc 509 requête 17440/90
La C.E.D.H a constaté qu'une saisie pénale non prévue par la loi au moment des faits mais par une loi postérieure est une violation de l'article 7 de la Convention
La loi pénale avait été appliquée rétroactivement.
Arrêt Ecer et Zeyreck contre Turquie du 27 février 2001; Hudoc 2374; requêtes 29295/95 et 29363/95
La C.E.D.H a constaté que d'appliquer une peine plus forte que la peine prévue au moment des faits par le jeu de la rétroactivité de la loi, est une violation de l'article 7 de la Convention.
Arrêt EK contre Turquie du 07 février 2002 Hudoc 3201 requête 28496/95
la Cour a constaté que la prononciation d'une peine contre un éditeur alors que la loi ne prévoyait de punir que le rédacteur en chef d'un journal, est une violation de l'article 7 de la Convention.
Arrêts K C. Allemagne requête n°61827/09 et G C. Allemagne requête n°65210/09 du 7 juin 2012
La Cour renvoie à sa conclusion dans une affaire précédente, M. c. Allemagne (1), dans laquelle elle a estimé que la détention de sûreté prévue par le droit pénal allemand devait être qualifiée de peine aux fins de l’article 7 § 1, considérant qu’elle est ordonnée par les juridictions pénales à la suite d’une condamnation pour une infraction et implique une privation de liberté pour une durée indéterminée. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.
La Cour n’est pas convaincue que les conditions de la détention de sûreté des requérants à la prison de Schwalmstadt, où M. K est toujours détenu et où M. G a été incarcéré avant son transfert dans un autre établissement, présentent des différences substantielles avec la situation du requérant en l’affaire M. c. Allemagne, d’autant que le requérant en cette affaire avait été placé en détention de sûreté dans le même établissement. Des changements mineurs dans le régime de détention ne sauraient masquer le fait qu’il n’existe aucune différence substantielle entre l’exécution de la peine d’emprisonnement et celle de l’ordonnance de placement en détention de sûreté. Dans un arrêt de principe du 4 mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a d’ailleurs estimé que le fait qu’il n’y ait pas de différence suffisamment marquée entre la détention de sûreté et la détention à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement était contraire à la Constitution.
La Cour souscrit à l’argument des requérants selon lequel les ordonnances par lesquelles ils ont été placés rétroactivement en détention de sûreté ont donné lieu à une nouvelle peine additionnelle, donc à une « peine plus forte » au sens de l’article 7 § 1. Au moment où ils ont commis des infractions, à savoir en 1985 et 1986 pour M. K et entre 1988 et 1990 dans le cas de M. G, il n’était pas possible de les placer en détention de sûreté en vertu d’une ordonnance rétroactive. La disposition fondant leur détention de sûreté n’a été introduite dans le code pénal allemand qu’en 2004, soit de nombreuses années après la commission des infractions.
Dans les deux cas, les juridictions ayant prononcé les condamnations se sont expressément refusées à ordonner le placement des requérants en détention de sûreté en plus de leur internement en hôpital psychiatrique. On ne saurait donc prétendre que ces jugements aient constitué la base du placement ultérieur des intéressés en détention de sûreté. En outre, en vertu de la jurisprudence établie des juridictions allemandes avant la modification du droit pénal en 2004, une personne ne pouvait plus être internée en hôpital psychiatrique et devait être libérée si elle ne souffrait plus d’aucune affection excluant ou atténuant sa responsabilité pénale.
Enfin, la Cour n’adhère pas à l’argument du gouvernement allemand selon lequel celui-ci, s’il avait ordonné la libération des requérants, aurait manqué à ses obligations au titre de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention s’agissant de protéger les victimes potentielles d’infractions de meurtre ou de violences sexuelles dont les requérants auraient pu se rendre coupables. La Cour souligne que la Convention n’oblige pas ni n’autorise les autorités nationales à protéger les personnes d’actes criminels d’un individu au mépris des droits reconnus à celui-ci par l’article 7 § 1.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 7 § 1 dans les deux affaires.
1 M. c. Allemagne, no 19359/04, arrêt du 17 décembre 2009.
LA NOUVELLE LOI OU JURISPRUDENCE QUI REFUSE LE CUMUL DES PEINES
NE PEUT PAS ETRE APPLIQUEE RETROACTIVEMENT AUX CONDAMNATIONS ANTERIEURES
DEL RIO PRADA c. ESPAGNE du 10 juillet 2012 Requête no 42750/09
b) Application des principes précités au cas d’espèce
49. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la reconnaissance de la culpabilité de la requérante et les différentes peines individuelles de prison auxquelles elle a été condamnée avaient pour base légale le droit pénal applicable à l’époque des faits, ce qu’elle n’a pas contesté.
50. L’argumentation des parties porte pour l’essentiel sur le calcul de la peine totale à purger résultant de l’application des règles en matière de cumul des peines, aux fins de l’application des remises de peines pertinentes. A cet égard, la Cour note que par une décision du 30 novembre 2000, l’Audiencia Nacional a fixé la limite maximale de l’accomplissement de toutes les peines prononcées à l’encontre de la requérante à trente ans d’emprisonnement, conformément à l’article 988 du code de procédure pénale et à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973, en vigueur au moment où les faits furent commis. Le 24 avril 2008, le centre pénitentiaire a fixé au 2 juillet 2008 la mise en liberté de la requérante, après avoir appliqué les remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d’emprisonnement. Par la suite, le 19 mai 2008, l’Audiencia Nacional a demandé aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue de remise en liberté et d’effectuer un nouveau calcul sur la base d’une nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt du Tribunal suprême 197/06 du 28 février 2006. Selon cette nouvelle jurisprudence, les bénéfices et remises de peines pertinents devaient être appliqués sur chacune des peines individuellement, et non sur la limite de trente ans d’emprisonnement. En application du nouveau critère, l’Audiencia Nacional a fixé le 27 juin 2017 comme date définitive de remise en liberté de la requérante.
51. La Cour est donc appelée à rechercher en l’espèce ce que la « peine » infligée à la requérante impliquait en droit interne. Elle doit en particulier se demander si le texte de la loi, combiné avec la jurisprudence interprétative dont il s’accompagnait, remplissait les conditions qualitatives d’accessibilité et de prévisibilité. Ce faisant, elle doit avoir en vue le droit interne dans son ensemble et la manière dont il était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145).
52. Certes, lorsque la requérante a commis les infractions, l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 faisait référence à la limite de trente ans d’emprisonnement en tant que limite maximale de l’accomplissement de la peine à purger (« condena ») en cas de peines multiples. Le concept de « peine à purger » (« condena ») semblait donc se distinguer de la notion de « peines prononcées » ou « imposées », c’est-à-dire les peines individuellement prononcées dans les différents jugements de condamnation. L’article 100 du code pénal de 1973, relatif aux remises de peines pour travail, établissait que le détenu bénéficie d’une remise d’un jour de privation de liberté pour deux jours de travail effectués, aux fins de l’accomplissement de la « peine imposée ». Or, cet article ne contenait aucune règle spécifique sur le calcul des remises de peines lorsque l’addition des peines imposées dépassait largement la limite de trente ans prévue à l’article 70 § 2 du code pénal, comme c’était le cas pour la requérante (plus de 3 000 ans d’emprisonnement). L’article 100 n’excluait l’application des remises de peines pour travail que dans deux cas bien précis : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se soustraire à l’exécution de la peine, ou en cas de mauvaise conduite (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe que ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995 que le législateur a prévu explicitement la possibilité d’appliquer les bénéfices pénitentiaires à la totalité des peines imposées et non à la limite maximale d’accomplissement prévue par la loi, et cela dans des cas exceptionnels (article 78 CP, paragraphe 23 ci-dessus).
53. La Cour doit aussi avoir égard à la jurisprudence et à la pratique interprétative sur les dispositions pertinentes du code pénal de 1973. Elle constate, comme l’admet le Gouvernement, que lorsqu’une personne était condamnée à plusieurs peines de prison, les autorités pénitentiaires, avec l’accord des autorités judiciaires, estimaient, comme formule d’application générale, que la limite établie à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 (trente ans d’emprisonnement) se transformait en une sorte de nouvelle peine autonome, sur laquelle devaient s’appliquer les bénéfices pénitentiaires (paragraphe 41 ci-dessus). Les autorités pénitentiaires envisageaient donc la remise de peines pour travail sur cette base de trente ans d’emprisonnement. Cette pratique ressort aussi de l’arrêt du Tribunal suprême du 8 mars 1994 (paragraphe 25 ci-dessus), premier éclaircissement jurisprudentiel du Tribunal suprême sur ce sujet, ainsi que de la pratique des tribunaux espagnols lorsqu’ils ont été appelés à déterminer la loi pénale la plus douce après l’entrée en vigueur du code pénal de 1995, comme le soulignaient les juges dissidents dans l’arrêt 197/2006 du Tribunal suprême (paragraphe 29 ci-dessus). Cette pratique a d’ailleurs bénéficié, dans des cas similaires à celui de la requérante, à de nombreuses personnes condamnées en vertu du code pénal de 1973, qui se sont vues appliquer des remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d’emprisonnement (paragraphe 29 ci-dessus).
20 ARRÊT DEL RIO PRADA c. ESPAGNE
54. La Cour estime que malgré l’ambigüité des dispositions applicables du code pénal de 1973 et le fait que le premier éclaircissement du Tribunal suprême à ce sujet n’a été donné qu’en 1994, la pratique des autorités pénitentiaires et des tribunaux espagnols consistait à considérer la peine à purger (« condena ») résultant de la limite de trente ans d’emprisonnement établie à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973 comme s’il s’agissait d’une nouvelle peine autonome, à laquelle on appliquait certains bénéfices pénitentiaires comme la remise de peines pour travail. C’est sur la base de cette pratique que la requérante pouvait espérer de façon légitime, pendant qu’elle purgeait sa peine de prison et notamment après les décisions de l’Audiencia Nacional du 30 novembre 2000 (sur le cumul des peines) et celle du 15 février 2001 (qui fixait au 27 juin 2017 la fin de la peine à purger), bénéficier des remises de peines pour le travail qu’elle avait effectué depuis 1987, à partir de l’hypothèse que la peine totale à purger était de trente ans.
55. Dès lors, la Cour admet qu’à l’époque où la requérante a commis les infractions, mais aussi au moment où la décision sur le cumul des peines a été prononcée, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble, y compris le droit jurisprudentiel, était formulé avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, la portée de la peine infligée et les modalités de son exécution (voir a contrario, Kafkaris, § 150).
56. Or, dans ses décisions du 19 mai 2008 et du 23 juin 2008, l’Audiencia Nacional a modifié la date prévue du 2 juillet 2008 pour la remise en liberté définitive de la requérante, telle qu’elle avait été calculée par le centre pénitentiaire. Pour ce nouveau calcul, l’Audiencia Nacional s’est appuyé sur la nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt du Tribunal suprême 197/06, du 28 février 2006 (paragraphes 27-28 ci-dessus), rendu bien après la commission des infractions par la requérante et la décision sur le cumul des peines. La Cour note que dans cet arrêt, le Tribunal suprême s’est écarté, à la majorité, de son précédent jurisprudentiel de 1994. Pour la majorité du Tribunal suprême, la nouvelle méthode de calcul était plus conforme au libellé même des dispositions du code pénal de 1973, qui faisait une distinction entre « peines imposées » et « peine à purger » (« condena »).
57. Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle-même pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle également que le principe de la légalité des délits et des peines, contenu dans l’article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété extensivement au détriment de l’accusé (voir par exemple Coëme et autres c. Belgique, CEDH 2000-VII, § 145).
58. La Cour relève que la nouvelle interprétation du Tribunal suprême, telle qu’appliquée au cas d’espèce, a abouti à allonger rétroactivement la peine que la requérante devait purger de presque neuf ans, dans la mesure où les remises de peines pour travail dont elle aurait pu se bénéficier sont devenues complètement inopérantes, compte tenu de la durée des peines auxquelles elle avait été condamnée. Dans ces circonstances, même si la Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel le calcul des bénéfices pénitentiaires en tant que tel sort du champ d’application de l’article 7, la manière dont les dispositions du code pénal de 1973 ont été appliquées allait au-delà. Dans la mesure où le changement de la méthode de calcul de la peine à purger a eu des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de la requérante, la Cour estime que la distinction entre la portée de la peine infligée à la requérante et les modalités de son exécution n’apparaissait donc pas d’emblée (voir, mutatis mutandis, Kafkaris, précité, § 148).
59. Eu égard à ce qui précède et à la lumière du droit espagnol pris dans son ensemble, la Cour estime que le nouveau mode de calcul des remises de peines applicables, sur la base du revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême, ne concernait pas seulement l’exécution de la peine infligée à la requérante. Il s’agissait d’une mesure qui a eu également un impact décisif sur la portée de la « peine » infligée à la requérante, aboutissant en pratique à l’allongement de presque neuf ans de la peine à purger.
60. Il reste à déterminer si cette interprétation des juridictions internes, intervenue bien après que la requérante eut commis les infractions qui lui étaient reprochées et même après la décision sur le cumul des peines du 30 novembre 2000, était raisonnablement prévisible par l’intéressée (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36). La Cour juge nécessaire, pour veiller à ce que la protection garantie par l’article 7 § 1 de la Convention reste effective, d’examiner le point de savoir si la requérante pouvait, au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste, prévoir que les juridictions internes retiendraient, une fois le cumul des peines prononcé par le juge de condamnation, une telle interprétation de la portée de la peine infligée, compte tenu notamment de la pratique jurisprudentielle et administrative antérieure à l’arrêt du 28 février 2006 (paragraphe 54 ci-dessus). A cet égard, la Cour constate que le seul précédent jurisprudentiel pertinent cité dans cet arrêt était celui du 8 mars 1994, dans lequel le Tribunal suprême avait suivi l’approche contraire, en faisant référence à l’article 59 du règlement pénitentiaire de 1981, en vigueur au moment où la requérante a commis les infractions. Par ailleurs, ainsi que l’ont fait observer les juges dissidents dans l’arrêt du 25 février 2006, les autres arrêts cités, même s’ils faisaient application du nouveau code pénal de 1995, suivaient une approche similaire en considérant le maximum légal d’accomplissement de la peine comme une nouvelle peine autonome (voir paragraphes 26 et 30 ci-dessus).
61. La Cour relève que le manque de jurisprudence préalable dans le même sens que l’arrêt du 28 février 2006 du Tribunal suprême résulte aussi de l’absence de précédents fournis par le Gouvernement, lequel admet que la pratique pénitentiaire et judiciaire préexistante allait dans le sens de l’arrêt du 8 mars 1994, c’est-à-dire dans le sens le plus favorable à la requérante (paragraphe 41 ci-dessus).
62. Au demeurant, la Cour constate que la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême a vidé de sens les remises de peines pour travail auxquelles des personnes condamnées sous l’ancien code pénal de 1973, telles que la requérante, auraient eu droit après avoir purgé une grande partie de leur peine. En d’autres termes, la peine que la requérante doit purger a été allongée jusqu’à 30 ans d’emprisonnement effectif, sur lesquels les remises de peines applicables auxquelles elle était antérieurement censée avoir droit n’ont eu aucune incidence. La Cour observe que ce revirement jurisprudentiel est intervenu après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995, qui a supprimé le système des remises de peines pour travail (paragraphe 23 ci-dessus) et qui a établi de nouvelles règles plus strictes en matière de calcul des bénéfices pénitentiaires pour les condamnés à de multiples peines de prison de longue durée (paragraphe 23 ci-dessus, article 78 du code pénal de 1995, tel que modifié par la loi organique 7/2003). A cet égard, si la Cour admet que les États sont libres de modifier leur politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et délits (Achour c. France [GC], n
o 67335/01, § 44, CEDH 2006-IV), elle considère que les juridictions internes ne sauraient appliquer rétroactivement et au détriment de l’intéressé l’esprit des changements législatifs intervenus après la commission de l’infraction. L’application rétroactive des lois pénales postérieures n’est admise que lorsque le changement législatif est favorable à l’accusé (voir Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009).
63. A la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il était difficile, voire impossible, pour la requérante de prévoir le revirement de jurisprudence du Tribunal suprême et donc de savoir, à l’époque des faits, ainsi qu’au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que l’Audiencia Nacional ferait un calcul des remises de peines sur la base de chacune des peines individuellement imposées et non sur celle de la peine totale à purger, allongeant ainsi substantiellement la durée de son emprisonnement.
64. Dès lors, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.
LA LOI SUR LA RECIDIVE PEUT ETRE RETROACTIVE
ARRÊT ACHOUR c FRANCE du 29 MARS 2006 Requête no 67335/01
"1. Principes généraux
41. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1627, § 29).
42. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29 ; Coëme et autres, précité, § 145 ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
43. La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145).
2. Application de ces principes
44. Le requérant se plaint d’avoir été déclaré en état de récidive lorsqu’il a été jugé et condamné pour les faits commis en 1995. La Cour doit donc assurément examiner le régime de la récidive et son application dans les circonstances de l’espèce. Elle estime cependant que les questions relatives à l’existence, aux modalités ainsi qu’aux justifications d’un régime de récidive relèvent du pouvoir qu’ont les Hautes Parties contractantes de décider de leur politique criminelle, sur laquelle elle n’a pas en principe à se prononcer. De même, les Hautes Parties contractantes sont libres de modifier, notamment en la renforçant, la répression des crimes et délits, sans que cela ne soulève de problème au regard des dispositions de la Convention, ce que le requérant admet.
45. Le régime juridique de la récidive en France comporte deux termes dont le premier est une condamnation pénale définitive et le second la commission d’une nouvelle infraction, soit identique ou équivalente à la première (récidive spéciale), soit distincte (récidive générale). Elle peut être temporaire, comme en l’espèce, ou permanente.
46. La récidive, qui est prévue par la loi, constitue une circonstance aggravante, in personam et non in rem puisqu’elle est attachée au comportement du délinquant, de la seconde infraction, ce qui justifie que le récidiviste soit, le cas échéant, condamné plus sévèrement. De l’avis de la Cour, la récidive ne peut résulter que de la commission d’une seconde infraction, mais pour que l’état de récidive soit juridiquement constitué, avec les conséquences qui s’ensuivent sur les peines encourues par le récidiviste, encore est-il nécessaire que, à la date de la seconde infraction, celle-ci entrât dans le champ temporel du délai légal de récidive, tel que fixé par les textes pertinents alors en vigueur.
47. Partant, la question soumise à la Cour concerne bien le respect ou non du principe de légalité des délits et des peines. La Cour doit notamment rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, remplissait les conditions d’accessibilité et de prévisibilité à l’époque des faits.
48. La Cour note que le requérant a été condamné une première fois le 16 octobre 1984 pour trafic de stupéfiants et qu’il a terminé de purger sa peine le 12 juillet 1986. Par la suite, il a été à nouveau condamné en raison d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant 1995 et jusqu’au 7 décembre 1995. Dans leurs décisions des 14 avril et 25 novembre 1997, le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Lyon ont déclaré le requérant coupable de faits réprimés par l’article 222-37 du code pénal et prononcé une peine conformément à cette disposition, ainsi qu’à l’article 132-9 du code pénal relatif à la récidive.
49. La Cour constate que l’article 132-9 prévoit que le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé en cas de récidive et ce, non plus dans un délai de cinq ans comme le prescrivait l’ancienne loi, mais dans les dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure. Ce nouveau régime légal étant entré en vigueur le 1er mars 1994, il était applicable lorsque le requérant a commis les nouvelles infractions au cours de l’année 1995, si bien que celui-ci avait juridiquement la qualité de récidiviste du fait de ces nouvelles infractions (paragraphe 46 ci-dessus).
50. Le requérant indique néanmoins que, du 13 juillet 1991 au 1er mars 1994, il n’était pas légalement possible de le considérer en état de récidive s’il avait commis ces infractions. Selon lui, un tel constat attesterait de la prescription de ce délai et de son extinction définitive.
51. La Cour rappelle cependant que la première condamnation du requérant, en date du 16 octobre 1984, n’était pas effacée et demeurait inscrite à son casier judiciaire. De fait, il était loisible au juge interne de prendre en compte ce premier terme pour retenir l’état de récidive, étant par ailleurs entendu que cette première condamnation et l’autorité de la chose jugée qui y est attachée n’ont aucunement été modifiées ou affectées d’une manière quelconque par l’adoption de la nouvelle loi. A cet égard, la Cour ne peut souscrire à l’argumentation du requérant (paragraphe 40 ci-dessus), selon lequel l’expiration du délai de récidive tel qu’il était prévu au moment de la commission de sa première infraction lui aurait conféré un « droit à l’oubli », un tel droit n’étant pas prévu par les textes applicables. Sa situation aurait, certes, été différente s’il avait été condamné à une peine assortie du sursis car dans ce cas, selon le système juridique de l’Etat défendeur, son absence de condamnation dans le délai légal en vigueur au moment de sa condamnation aurait privé celle-ci d’effet pour l’avenir. Mais rien de tel n’existe pour une condamnation sans sursis sujette au régime de récidive, et, ainsi qu’elle l’a déjà observé (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour considère que le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention.
52. Par ailleurs, la Cour constate que la jurisprudence de la Cour de cassation règle depuis longtemps la question de savoir si une loi nouvelle allongeant le délai entre les deux termes de la récidive peut s’appliquer à une seconde infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur. En effet, par une jurisprudence claire et constante depuis la fin du 19e siècle, ce qui n’est pas contesté par le requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide que lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur. Une telle jurisprudence était à l’évidence de nature à permettre à M. Achour de régler sa conduite (voir, parmi d’autres, Kokkinakis, précité, p. 19, § 40 ; Cantoni, précité, pp. 1628-1629, § 34 ; Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 82, CEDH 2001-II).
53. Il ne fait dès lors aucun doute que le requérant pouvait prévoir qu’en commettant une nouvelle infraction avant le 13 juillet 1996, échéance du délai légal de dix ans, il courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende susceptible d’être doublée. Il était donc en mesure de prévoir les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.
54. En tout état de cause, la condition de « prévisibilité » de la loi peut être remplie lorsque la personne concernée est amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Cantoni, précité, p. 1629, § 35).
55. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que tant le droit d’origine jurisprudentiel que le droit d’origine législative étaient « prévisibles » au sens de l’article 7 de la Convention.
56. En outre, la Cour estime que le grief soulevé par le requérant concerne en réalité une situation d’applications successives de la loi pénale dans le temps.
57. Partant, elle ne relève aucune incohérence dans le fait que le requérant ait pu relever de situations légales différentes, notamment en ce qui concerne la période du 13 juillet 1991 au 28 février 1994 et celle qui a suivi avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994.
58. De même, il ne saurait davantage y avoir aucun problème de rétroactivité s’agissant d’une simple succession de lois qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur.
59. Certes, les juges internes ont tenu compte de la condamnation prononcée en 1984, constitutive du premier terme, pour retenir la récidive. Néanmoins, la prise en compte rétrospective de la situation pénale antérieure du requérant par les juges du fond, rendue possible par l’inscription au casier judiciaire de la condamnation de 1984, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7, les faits poursuivis et sanctionnés étant quant à eux effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’article 132-9 du nouveau code pénal. En tout état de cause, une telle démarche rétrospective se distingue de la notion de rétroactivité stricto sensu.
60. En conclusion, la peine infligée au requérant, déclaré coupable et en état de récidive dans la procédure litigieuse, était applicable au moment où la seconde infraction a été commise, par application d’une « loi » accessible et prévisible. M. Achour pouvait donc précisément connaître, à l’époque des faits, les conséquences légales de ses actes délictueux.
61. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention."
LA LOI SUR LES CRIMES DE GUERRE N'EST PAS RETROACTIVE
L'affaire Kononov sur les crimes de guerre des soviétiques.
Cette affaire a donné lieu à un arrêt de la chambre, un arrêt de la grande chambre et à des opinions dissidentes.
Requête no 36376/04 KONONOV c. LETTONIE
Un héro de guerre soviétique poursuivi pour crime contre l'humanité
En août 1940, la Lettonie devint une partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques (« URSS ») sous le nom de « République socialiste soviétique de Lettonie » (« RSS de Lettonie »). Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaqua l'URSS. Devant l'avancée des forces allemandes, l'armée soviétique dut quitter la région balte et se replier en Russie.
Le requérant, qui vivait alors dans une région frontalière, suivit le mouvement. Le 5 juillet 1941, toute la Lettonie se trouva envahie par les forces allemandes. Après son arrivée en URSS, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l'armée soviétique en 1942 et affecté au régiment de réserve de la division lettonne. De 1942 à 1943, il suivit une formation spéciale aux missions de sabotage, où il apprit à organiser et à mener des opérations de commando derrière les lignes ennemies. A la fin de cet entraînement, il fut promu au grade de sergent. En juin 1943, il fut parachuté, avec une vingtaine d'autres soldats, sur le territoire biélorusse, alors occupé par l'Allemagne, près de la frontière avec la Lettonie, et donc de sa région natale. Il devint membre d'un commando soviétique composé de « partisans rouges » (combattants soviétiques qui menaient une guérilla contre les forces allemandes). En mars 1944, il fut placé par ses deux supérieurs directs à la tête d'un peloton qui, d'après lui, avait principalement pour objectifs de saboter des installations militaires, des lignes de communication et des points de ravitaillement allemands, de faire dérailler des trains et de diffuser de la propagande politique au sein de la population locale. Il aurait par la suite été responsable du déraillement de seize trains militaires et de la destruction de quarante-deux cibles militaires allemandes.
Les événements du 27 mai 1944, tels qu'établis par les juridictions internes
En février 1944, l'armée allemande découvrit et anéantit un groupe de partisans rouges, dirigé par le commandant Tchougounov, qui s'était caché dans la grange de Meikuls Krupniks, dans le village de Mazie Bati. L'administration militaire allemande avait fourni à quelques hommes de Mazie Bati un fusil et deux grenades chacun. Soupçonnant les villageois d'avoir espionné pour le compte des Allemands et de leur avoir livré les hommes de Tchougounov, le requérant et les membres de son unité décidèrent de mener une action de représailles.
Le 27 mai 1944, armés et portant l'uniforme de la Wehrmacht pour ne pas éveiller les soupçons, ils pénétrèrent dans le village de Mazie Bati. Les habitants s'apprêtaient à fêter la Pentecôte. L'unité se divisa en plusieurs petits groupes, qui attaquèrent chacun une maison, sur les ordres du requérant.
Plusieurs partisans firent irruption chez le paysan Modests Krupniks, saisirent les armes qu'ils trouvèrent dans sa maison et lui ordonnèrent de sortir dans la cour. Comme il les suppliait de ne pas le tuer sous les yeux de ses enfants, ils le firent courir en direction de la forêt, puis l'abattirent de plusieurs coups de feu. Krupniks fut laissé, grièvement blessé, à la lisière de la forêt, où il décéda le lendemain matin.
Deux autres groupes de partisans rouges attaquèrent les maisons de deux autres paysans, Meikuls Krupniks et Ambrozs Buļs. Le premier, appréhendé alors qu'il prenait son bain, fut sévèrement battu. Après avoir saisi les armes trouvées chez les deux villageois, les partisans les déposèrent dans la maison de Meikuls Krupniks, où ils tirèrent plusieurs rafales de balles sur Ambrozs Buļs ainsi que sur Meikuls Krupniks et sa mère. Ces deux derniers furent grièvement blessés. Les partisans arrosèrent ensuite la maison et toutes les dépendances d'essence et y mirent le feu. La femme de Krupniks, enceinte de neuf mois, parvint à s'échapper, mais les partisans la rattrapèrent et la jetèrent par la fenêtre à l'intérieur de la maison en flammes. Le lendemain matin, les survivants retrouvèrent les restes des corps calcinés des quatre victimes ; le cadavre de Mme Krupniks fut identifié d'après le squelette carbonisé du bébé qui gisait à ses côtés.
Un quatrième groupe de partisans fit irruption chez Vladislavs Šķirmants, alors que celui-ci était sur son lit avec son fils âgé d'un an. Après avoir découvert un fusil et deux grenades cachés au fond d'un placard, les partisans firent sortir Šķirmants dans la cour. Ils verrouillèrent alors la porte de l'extérieur afin d'empêcher Mme Šķirmants de suivre son mari, puis emmenèrent celui-ci dans un coin reculé de la cour et l'abattirent. Un cinquième groupe attaqua la maison de Juliāns Šķirmants. Après y avoir trouvé et saisi un fusil et deux grenades, les partisans emmenèrent Juliāns Šķirmants dans la grange, où ils l'exécutèrent. Un sixième groupe s'en prit à la maison de Bernards Šķirmants. Les partisans saisirent les armes qu'ils découvrirent chez lui, le tuèrent, blessèrent sa femme et mirent le feu à tous les bâtiments de la ferme. La femme de Šķirmants fut brûlée vive avec le cadavre de son mari.
Le requérant conteste les faits
Tous les villageois décédés étaient des collaborateurs et des traîtres qui avaient livré le peloton du commandant Tchougounov (qui comportait des femmes et un enfant en bas âge) aux Allemands en février 1944. Trois femmes – la mère de Meikuls Krupniks, son épouse et celle de Bernards Šķirmants – avaient assuré au peloton de Tchougounov que la Wehrmacht était loin, mais Šķirmants avait envoyé Krupniks alerter les forces allemandes. Une fois arrivés, les soldats allemands avaient mis le feu à la grange (où se cachait le peloton) en la mitraillant avec des balles incendiaires. Les membres du peloton qui avaient tenté de s'échapper avaient été abattus. La mère de Krupniks avait dépouillé les cadavres de leurs manteaux. Le commandement militaire allemand avait récompensé les villageois concernés en leur offrant du bois de chauffage, du sucre, de l'alcool et de l'argent. Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants étaient des Schutzmänner (auxiliaires de la police allemande).
Le 27 mai 1944, environ une semaine avant les événements litigieux, le requérant et tous les hommes de son peloton avaient été convoqués par leur commandant. Celui-ci les avait informés qu'ils étaient chargés de l'exécution de la sentence condamnant les habitants de Mazie Bati impliqués dans la trahison du groupe de Tchougounov qui avait été prononcée par un tribunal militaire ad hoc. Plus précisément, ils devaient « amener les six Schutzmänner de Mazie Bati aux fins de leur jugement ». Le requérant ayant refusé de diriger l'opération (comme les villageois le connaissaient depuis son enfance, il craignait pour la sécurité de ses parents, qui résidaient dans le village voisin), le commandant avait confié la mission à un autre partisan, et c'est ce dernier qui avait donné les ordres.
Le 27 mai 1944, le requérant avait suivi les hommes de son unité. Il n'était pas entré dans le village, mais s'était caché derrière un buisson d'où il pouvait observer la maison de Modests Krupniks. Peu après, il avait entendu des cris et des coups de feu et aperçu de la fumée. Un quart d'heure plus tard, les partisans étaient revenus seuls. L'un d'eux était blessé au bras ; un autre portait six fusils, dix grenades et un grand nombre de cartouches qui avaient été saisis chez les villageois. Les hommes du requérant lui avaient expliqué plus tard qu'ils n'avaient pas pu exécuter leur mission parce que « les villageois s'étaient enfuis en leur tirant dessus et les Allemands étaient arrivés ». L'unité du requérant n'avait pas pillé Mazie Bati. Lorsque les partisans étaient revenus à leur base, le commandant les avait sévèrement réprimandés pour n'avoir pas ramené les personnes recherchées.
Les événements ultérieurs
25. En juillet 1944 l'Armée rouge entra en Lettonie et le 8 mai 1945 le territoire letton passa sous le contrôle des forces soviétiques.
26. Après la fin des hostilités, le requérant demeura en Lettonie. Il fut décoré de l'ordre de Lénine, la plus haute distinction soviétique, pour ses exploits militaires. En novembre 1946, il adhéra au Parti communiste de l'Union soviétique. En 1957, il sortit diplômé de la grande école du ministère de l'Intérieur de l'URSS. Par la suite et jusqu'à sa retraite en 1988, il travailla comme agent dans différentes branches de la police soviétique.
27. Le 4 mai 1990, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta la « Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la république de Lettonie », déclarant illégitime et nulle l'incorporation de la Lettonie à l'URSS en 1940 et redonnant force de loi aux dispositions fondamentales de la Constitution de 1922. Le même jour, il adopta la « Déclaration relative à l'adhésion de la république de Lettonie aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme ». L'« adhésion » proclamée par ladite déclaration signifiait l'acceptation unilatérale et solennelle des valeurs consacrées par les textes en question. Plus tard, la Lettonie signa et ratifia selon la procédure établie la plupart des textes conventionnels visés par la déclaration.
28. Le 21 août 1991, après deux tentatives avortées de coup d'Etat, le Conseil suprême adopta une loi constitutionnelle concernant le statut étatique de la république de Lettonie et proclamant l'indépendance absolue et immédiate du pays.
29. Le 22 août 1996, le Parlement letton adopta la « Déclaration sur l'occupation de la Lettonie ». Aux termes de ce texte, l'annexion du territoire letton par l'URSS en 1940 s'analysait en une « occupation militaire » et en une « incorporation illégale ». Quant à la reprise par l'URSS de ce territoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle fut qualifiée de « rétablissement d'un régime d'occupation».
Le droit international pertinent avant 1944
La première codification juridiquement contraignante des lois et coutumes de la guerre fut la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, élaborée et ouverte à la signature lors de la première conférence internationale de la paix de La Haye. En annexe à cette Convention se trouve un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Tant la Convention que le règlement entrèrent en vigueur le 28 juin 1907.
Le 18 octobre 1907, lors de la deuxième conférence internationale de la paix, fut signée une deuxième convention qui porte le même titre et, tout comme le texte précédent, renferme un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les deux versions de la Convention et du règlement ne présentent que de très légères différences. Aux termes de l’article 4 de la seconde Convention – entrée en vigueur le 11 juillet 1910 – cette seconde Convention remplace celle de 1899 ; cependant, cette dernière « rest[ait] en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’[avaient] signée et qui ne ratifieraient pas également la [nouvelle] Convention ». Tant l’Empire allemand que l’Empire russe ratifièrent cette nouvelle Convention le 27 novembre 1909. En revanche, la Lettonie ne le fit jamais.
Les alinéas pertinents du préambule de la Convention de 1907 se lisent comme suit :
« (...) Estimant qu’il importe (...) de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs,
[Les Hautes Parties contractantes] ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;
D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
L’article 2 de la Convention de 1907 énonce :
« Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. »
Les articles pertinents du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre – parfaitement identiques dans les deux versions – sont ainsi libellés :
Article 1er
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1o d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,
2o d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance,
3o de porter les armes ouvertement, et
4o de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée. »
Article 2
« La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »
Article 3
« Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. (...) »
Article 22
« Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. »
Article 23, alinéa 1
« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : (...)
b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; (...)
g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; (...). »
Article 24
« Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. »
Article 25
« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »
Article 28
« Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. »
Article 42
« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »
Article 46
« L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée. »
Article 47
« Le pillage est formellement interdit. »
Article 50
« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. »
ARRET DE LA CHAMBRE DU 26 JANVIER 2009
a) Les principes généraux
113. La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A nos 335-B et 335-C, p. 41, § 34, et p. 68, § 32, respectivement).
114. Les principes généraux établis par la jurisprudence constante de la Cour quant à l’interprétation de l’article 7 § 1 sont les suivants:
a) L’article 7 § 1 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). La première tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition de droit national ou international rendant cet acte punissable. Suivant la même logique, l’article 7 interdit, premièrement, d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, et, deuxièmement, d’appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d’autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII).
b) Le droit pénal doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, 29 mars 2006). Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1627, § 29). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (Coëme et autres, arrêt précité, loc.cit.).
c) Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, § 50).
d) La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).
e) D’après les principes généraux du droit, on ne peut se fonder, pour justifier un comportement ayant abouti à une condamnation, sur la seule constatation qu’un tel comportement a eu lieu et, de ce fait, a formé une pratique. Par conséquent, une pratique étatique consistant à tolérer ou à encourager certains actes déclarés criminels par le droit positif national ou international, et le sentiment d’impunité qui en résulte pour leurs auteurs, ne constituent pas un obstacle à ce que ceux-ci soient poursuivis et châtiés (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, §§ 74, 77-79 et 87-88).
f) Dans l’hypothèse d’une succession d’Etats ou d’un changement de régime politique sur le territoire national, il est tout à fait légitime pour un Etat de droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur. De même, on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales existantes à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit (ibidem, § 81, ainsi que K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 84, CEDH 2001-II (extraits)).
115. Pour ce qui est de l’article 7 § 2, les organes de la Convention ont déclaré ce qui suit :
a) Le second paragraphe de l’article 7 de la Convention relatif « au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », constitue une clause de dérogation exceptionnelle au principe général contenu dans le premier. Les deux paragraphes constituent ainsi un système uni et doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002).
b) Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le second paragraphe de l’article 7 a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l’ennemi ; dès lors, il ne vise aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (X. c. Belgique, no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241). Ce raisonnement vaut également pour les crimes contre l’humanité perpétrés pendant la même période (Touvier c. France, no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (DR) 88, p. 148, et Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001-XII (extraits)).
b) L’application de ces principes dans la présente affaire
i. Article 7 § 1
116. A la lumière des principes énoncés ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes. Sa seule tâche est d’examiner, sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention, si, à la date du 27 mai 1944, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national ou international (K.-H.W. c. Allemagne, précité, § 46).
α – Le droit international
117. La Cour note que le requérant a été condamné à une peine de prison en vertu de l’article 68-3 de l’ancien code pénal letton, inséré par la loi du 6 avril 1993 et relatif aux crimes de guerre. Bien que cette disposition renfermât une énumération sommaire des actes réprimés – meurtre, torture, pillage, etc., – elle renvoyait directement aux « actes normatifs conventionnels pertinents » pour une définition précise desdits actes (paragraphe 53 ci-dessus). La condamnation litigieuse était donc fondée sur le droit international plutôt que sur le droit interne et, aux yeux de la Cour, c’est avant tout dans cette perspective qu’il faut l’examiner.
118. La Cour relève ensuite que, dans son arrêt du 30 avril 2004, confirmé en cassation, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême a qualifié les actes du requérant sous l’angle de trois textes conventionnels internationaux : la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ou, plus précisément, le règlement y annexé), la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et, enfin, le Protocole additionnel à cette dernière, adopté en 1977. De ces trois textes, seule la Convention de La Haye existait et était en vigueur au moment des faits incriminés, en 1944. Quant aux deux autres, ils ont été élaborés postérieurement aux faits litigieux et ne contiennent aucune clause leur accordant une force rétroactive quelconque.
119. A cet égard, la Cour comprend mal l’affirmation du sénat de la Cour suprême selon laquelle l’application rétroactive de ces deux textes serait autorisée par la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (paragraphe 69 ci-dessus). En effet, cette convention régit uniquement la question de la prescription légale et est muette sur celle de la rétroactivité des lois. Au demeurant, la Cour estime que, dans les cas similaires à celui de l’espèce, où la loi pénale nationale renvoie au droit international pour la définition d’une infraction, la disposition interne et la disposition internationale forment, au sens matériel, une seule et unique norme pénale couverte par les garanties de l’article 7 § 1 de la Convention. Dès lors, cet article s’oppose à ce qu’un traité international soit appliqué rétroactivement pour qualifier un acte ou une omission de criminels.
120. La Cour observe que l’URSS ne figurait pas plus que la Lettonie parmi les signataires de la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, conformément à la clause de « participation générale » contenue dans son article 2, ce texte n’était pas formellement applicable dans le conflit armé en cause. Cependant, comme le Tribunal militaire international de Nuremberg l’a relevé dans son jugement du 1er octobre 1946, le texte de cette convention constituait une codification de règles coutumières qui, en 1939 – c’est-à-dire au moment où la guerre avait commencé – « étaient admises par tous les États civilisés » (paragraphe 61 ci-dessus). De même, aux termes du jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient du 12 novembre 1948, « [cette] Convention rest[ait] une bonne démonstration du droit coutumier des nations » (paragraphe 64 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour relève que la Convention de 1907 reproduit presque littéralement le texte de la Convention de La Haye de 1899, qui, d’après la volonté exprimée par ses auteurs dans son préambule, constituait, du moins en partie, une codification de certains principes préexistants du droit des gens. Or, si ces principes étaient déjà largement reconnus à la fin du XIXe siècle, il n’y a aucune raison de douter de leur nature universelle au milieu du XXe, lors de la Seconde Guerre mondiale. Au demeurant, la Cour a jugé que la notion de « droit » inscrite à l’article 7 § 1 de la Convention comprend en principe le droit écrit aussi bien que non écrit (K.-H.W. c. Allemagne, arrêt précité, § 54).
121. Selon le requérant, les dispositions de la Convention de La Haye seraient inapplicables ratione personae aux événements de Mazie Bati : en effet, ce texte parle de « l’ennemi », alors que les villageois tués le 27 mai 1944 étaient ses concitoyens. La Cour ne peut pas accepter cet argument. D’une part, elle relève qu’à la date susmentionnée, la région où se trouvait le village en cause était effectivement occupée par les forces armées de l’Allemagne nazie, l’une des parties belligérantes de la Seconde Guerre mondiale, que cette région était placée sous administration militaire allemande, et que, de surcroît, le village se trouvait dans une zone d’hostilités à proximité de la ligne du front. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant et les hommes de son peloton étaient membres de l’armée soviétique, donc « combattants » au sens du droit international ; dès lors, ils étaient censés connaître les règles universellement acceptées du jus in bello et s’y conformer en toute situation. Selon la Cour, cela suffit pour conclure que le contenu matériel du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 était applicable aux faits litigieux.
122. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse séparée de l’accessibilité des dispositions dudit règlement à la date du 27 mai 1944. En effet, même si l’URSS n’avait pas ratifié la Convention de La Haye, son texte ne faisait que reproduire les règles coutumières fondamentales fermement reconnues par la communauté des nations de l’époque. La Cour présume donc que le requérant, en sa qualité de militaire, devait connaître ces règles. Elle souligne ensuite qu’il ne lui appartient ni d’interpréter la Convention de La Haye par voie d’autorité, ni d’établir le contenu exact de la notion de « crime de guerre » telle qu’elle se présentait en 1944 (voir, mutatis mutandis, Behrami et Behrami c. France (déc.) [GC], no 71412/01, et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], no 78166/01 (affaires jointes), § 122, CEDH 2007-...). En revanche, il lui incombe d’examiner le respect du critère de prévisibilité dans la présente affaire. Plus précisément, la Cour doit dire, d’un point de vue objectif, s’il existait une base juridique plausible pour condamner le requérant pour un crime de guerre, et, d’un point de vue subjectif, si, à l’époque des faits, l’intéressé pouvait raisonnablement prévoir qu’il se rendait coupable d’un tel crime.
124. La Cour relève que les décisions des juridictions nationales sont presque totalement muettes sur l’implication personnelle directe du requérant dans les événements de Mazie Bati, c’est-à-dire sur ses faits et gestes précis à cette occasion. Bien qu’il eût été initialement inculpé du meurtre d’Ambrozs Buļs et de Bernards Šķirmants, ainsi que, semble-t-il, de tortures infligées aux villageois, il fut par la suite acquitté relativement à ces épisodes, et ceux-ci furent retirés de l’accusation (paragraphe 45 ci-dessus). Eu égard au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour admet donc que le requérant n’a jamais commis les actes en cause. Dans ces circonstances, et en l’absence d’indications plus précises sur la participation personnelle de l’intéressé aux actes perpétrés, elle en déduit que le seul fait réellement reproché au requérant était d’avoir dirigé le commando qui effectua l’opération punitive du 27 mai 1944. Dès lors, il lui faut rechercher si cette opération pouvait, en tant que telle, raisonnablement passer pour être contraire aux lois et coutumes de la guerre codifiées par la Convention de La Haye de 1907.
125. Pour répondre à cette question, la Cour doit tenir compte, premièrement, des conditions qui régnaient en mai 1944 dans la région de Mazie Bati, et, deuxièmement, du comportement des villageois tués par le commando du requérant. S’agissant du contexte général des événements du 27 mai 1944, la Cour admet qu’ils n’ont pas eu lieu dans une situation de combat. Toutefois, elle relève que le village de Mazie Bati était alors situé à environ 80 kilomètres de la ligne du front, qu’il se trouvait dans une région occupée par l’Allemagne nazie et envahie par la Wehrmacht, que dans cette région des commandos des partisans rouges menaient une guérilla contre les Allemands, et que des affrontements armés eurent lieu jusque dans le village même (paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Bref, la localité en cause et toute la région alentour furent en proie aux hostilités de la guerre. Par ailleurs, il ressort des pièces d’archives présentées par le Gouvernement qu’outre les forces allemandes et soviétiques il existait dans cette région une police auxiliaire lettonne au service des Allemands ; que, dans au moins un des villages du même district, cette police avait constitué un « groupe de défense » armé composé d’« hommes de confiance » locaux, et que d’autres « hommes de confiance » avaient été nommés dans certains autres villages pour surveiller les suspects et démasquer et dénoncer les partisans rouges (paragraphes 27-28 ci-dessus).
126. Pour ce qui est des neuf victimes du commando, la Cour constate qu’il existe une controverse entre les parties au sujet de leur statut exact au regard du droit international applicable à l’époque. Le gouvernement défendeur se rallie à la position des juridictions lettonnes selon laquelle ces villageois devaient être considérés comme des « civils », avec toutes les garanties qu’entraînait ce statut. Quant au requérant et au gouvernement russe, ils contestent cette qualification. La Cour, pour sa part, estime qu’il faut examiner séparément la situation des six hommes et celle des trois femmes qui ont péri dans l’incident en cause.
127. S’agissant des hommes, la Cour note d’emblée que rien dans le dossier n’atteste leur appartenance à la police auxiliaire lettonne (les Schutzmänner). Les allégations du requérant doivent donc être écartées sur ce point. En revanche, nul ne conteste que tous ces hommes avaient reçu des fusils et des grenades de l’administration militaire allemande ; le fait qu’ils ne les portaient pas ostensiblement au moment de l’attaque des partisans rouges est sans importance en l’espèce. Il ressort du dossier qu’il n’est plus possible d’établir la raison exacte pour laquelle les Allemands avaient armé ces six paysans (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour relève cependant l’existence de plusieurs indices concordants susceptibles d’apporter certains éclaircissements sur ce point.
128. En effet, les parties s’accordent à dire qu’en février 1944, donc environ trois mois avant les événements litigieux, la Wehrmacht avait attaqué une grange, située sur le territoire de Mazie Bati et dans laquelle s’était réfugié un groupe de partisans rouges dirigé par le major Tchougounov. A la suite de cette attaque, le groupe avait trouvé la mort. Le Gouvernement ne conteste guère l’assertion du requérant selon laquelle c’étaient les villageois qui avaient informé les Allemands de la présence des partisans dans la grange, et selon laquelle c’étaient, plus précisément, Meikuls Krupniks (propriétaire de la grange), Bernards Šķirmants et les trois femmes en cause qui avaient participé à cette trahison. Qui plus est, les juridictions de première instance et d’appel l’ont expressément reconnu : soit concernant tous les hommes en cause, soit, du moins, concernant Meikuls Krupniks (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). Enfin, ni les tribunaux internes dans leurs décisions ni le Gouvernement dans ses observations n’ont réfuté l’allégation selon laquelle les villageois concernés avaient été récompensés par le commandement militaire allemand pour leur acte (paragraphe 22 ci-dessus).
129. Dans le même arrêt, la chambre des affaires pénales mentionne les gardes nocturnes que les villageois de Mazie Bati montaient régulièrement. Or, ce fait rappelle la pratique déjà évoquée, établie par la police auxiliaire lettonne dans les villages voisins et rapportée, par exemple, dans l’ordre écrit du commandant local de cette police du 25 février 1944 (paragraphe 27 ci-dessus). En l’occurrence, il suffit à la Cour de conclure que, vu le comportement de ces hommes et les conditions régnant à l’époque dans la région en question, le requérant et les autres partisans rouges pouvaient légitimement considérer ces paysans non comme des « habitants pacifiques » – terme utilisé en l’espèce par le sénat de la Cour suprême – mais comme des collaborateurs de l’armée allemande.
130. Dans son arrêt du 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales a tenté de justifier cette collaboration par la nécessité, pour les personnes concernées, de se défendre elles-mêmes et de protéger leurs familles contre les partisans rouges. La Cour ne peut pas accepter cet argument. En premier lieu, elle tient à rappeler que le national-socialisme est, en tant que tel, absolument contraire aux valeurs les plus fondamentales sous-tendant la Convention ; par conséquent, quelle que soit la raison invoquée, elle ne saurait accorder une légitimation quelconque à une attitude pronazie ou une collaboration active avec les forces de l’Allemagne nazie (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2886, § 53, ainsi que Marais c. France, no 31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86, p. 184, et Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX). En deuxième lieu, les villageois susvisés ne pouvaient ignorer que, s’engageant ainsi du côté de l’une des parties belligérantes, ils s’exposaient, justement, au danger de représailles de la part de l’autre.
131. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que les six hommes tués le 27 mai 1944 pouvaient raisonnablement passer pour des « civils ». A cet égard, elle relève que le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 ne définit pas les notions de « personne civile » ou de « population civile ». En l’occurrence, pour qualifier ainsi les victimes de Mazie Bati, la chambre des affaires pénales s’est appuyée sur l’article 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté en 1977. Cet article contient effectivement une présomption selon laquelle toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories prédéfinies de combattants, ou faisant l’objet d’un doute sur ce point, doit être considérée comme « civile » (paragraphe 67 ci-dessus). Or, comme la Cour l’a déjà dit, ce Protocole, élaboré et adopté plus de trente ans après les événements litigieux, ne peut pas être appliqué rétroactivement pour qualifier les faits reprochés au requérant. Par ailleurs – partant du principe que les textes conventionnels précités représentent un progrès, et non une régression, du droit international humanitaire –, puisqu’une telle présomption ne figurait pas encore dans la Convention de Genève de 1949, il n’y aucune raison de penser qu’elle était déjà reconnue en droit coutumier en 1944. Qui plus est, la Convention de 1949 prévoit elle-même, en son article 5, des exceptions permettant de priver de leurs droits et privilèges spéciaux les personnes ayant abusé de leur statut de « civil » (paragraphe 66 ci-dessus). En résumé, rien ne montre qu’au sens du jus in bello tel qu’il existait en 1944 toute personne ne réunissant pas les conditions formelles pour être qualifiée de « combattant » devait automatiquement être rangée dans la catégorie des « civils » avec toutes les garanties qui en découlaient.
132. La Cour note ensuite que l’opération du 27 mai 1944 a revêtu un caractère sélectif. En effet, il ressort clairement du dossier que les partisans rouges n’ont jamais eu l’intention d’attaquer le village de Mazie Bati en tant que tel – par exemple, pour éliminer tous ses habitants et détruire tous ses bâtiments par le feu. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de résoudre la controverse entre les parties quant à l’existence d’un jugement d’un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement des partisans ; il lui suffit simplement de constater que l’opération litigieuse était dirigée contre six hommes précis bien identifiés, que l’on soupçonnait fortement de collaborer avec l’occupant nazi. Arrivés chez chacun de ces six chefs de famille, les partisans fouillèrent leurs maisons, et ce n’est qu’après avoir trouvé des fusils et des grenades remis par les Allemands – preuve tangible de leur collaboration – qu’ils les exécutèrent. En revanche, à l’exception des trois femmes dont la Cour examinera la situation ci-après, tous les autres villageois furent épargnés. La Cour relève en particulier qu’aucun des enfants en bas âge – y compris ceux des personnes exécutées – qui se trouvaient au village au moment de l’attaque n’a souffert (paragraphes 16 et 36 a) ci-dessus). Enfin, seules deux maisons, qui appartenaient à Meikuls Krupniks et à Bernards Šķirmants, furent brûlées.
133. La Cour estime qu’il convient d’analyser les dispositions précises du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907, afin de déterminer s’il existait une base juridique plausible pour condamner le requérant pour au moins un acte qu’il interdit. A cet égard, elle note que, dans leurs décisions, les juridictions lettonnes ont omis de procéder à une analyse détaillée et suffisamment approfondie du texte susmentionné, se contentant de renvoyer à certains de ses articles sans expliquer dans quelle mesure ils entraient en jeu dans le cas du requérant. Dans ces conditions, et en l’absence, à l’époque, d’une jurisprudence ou d’une pratique nationale ou internationale établie interprétant la Convention de La Haye et le règlement y annexé, la Cour considère qu’il échet de s’en tenir au sens littéral et universellement accepté des termes qui y sont employés.
134. Dans son arrêt du 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales invoque trois articles du règlement en question : l’article 23, alinéa 1, point b), qui interdit « de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie », l’article 25, qui interdit des attaques contre « des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus », et, enfin, l’article 46, alinéa 1, qui impose le respect de certains droits les plus fondamentaux, comme « l’honneur (...), les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée ». Or, en l’espèce, on est en présence d’une opération militaire ciblée ayant consisté en une exécution ponctuelle de collaborateurs armés par l’ennemi nazi, qui faisaient l’objet d’une suspicion légitime de représenter un danger pour les partisans rouges et dont les agissements avaient déjà causé la mort de leurs camarades. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il s’agissait d’un « village non défendu ». En effet, cette opération ne semble guère différente de celles effectuées à la même époque par les forces armées des Alliés et par les résistants locaux dans de nombreux pays européens occupés par l’Allemagne nazie. De même, les juridictions internes ont failli à expliquer en quoi cette opération aurait été effectuée « par trahison », au sens de l’article 23 du règlement de La Haye, et non par l’emploi de « ruses de guerre » légitimes, autorisées par l’article 24 du même texte.
135. Enfin, pour ce qui est du « pillage », également reproché par les tribunaux au requérant et formellement interdit par les articles 28 et 47 du règlement susmentionné, la Cour rappelle encore une fois que le requérant n’a pas été condamné de ce chef et que l’accusation de vol aux villageois d’effets personnels ou de produits alimentaires n’a finalement pas été retenue contre lui. Quant à la saisie, par les partisans rouges, des armes remises aux hommes de Mazie Bati par l’administration militaire allemande, la Cour considère que cet acte ne peut en aucun cas être qualifié de « pillage » au sens normalement attribué à ce terme, les armes n’entrant pas dans la catégorie des « biens privés ».
136. Selon le Gouvernement, à la date du 27 mai 1944, le requérant était en mesure de prévoir qu’il se rendait coupable d’un crime de guerre puisqu’avant cette date les autorités soviétiques avaient déjà jugé et condamné à mort un certain nombre de militaires allemands pour des exactions de même nature que celles que son groupe était en train de perpétrer. A cet égard, le Gouvernement invoque en particulier le procès de Kharkov qui s’était déroulé environ six mois auparavant (paragraphes 71-75 ci-dessus). Toutefois, la Cour note qu’il a omis d’expliquer en quoi le comportement du commando engagé dans l’opération de Mazie Bati serait identique ou similaire aux actes commis par les Allemands jugés à Kharkov. Quant aux décisions des juridictions internes, elles sont muettes sur ce point. Dès lors, cette thèse du Gouvernement ne saurait être retenue.
137. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été suffisamment démontré que l’attaque du 27 mai 1944 était, en tant que telle, contraire aux lois et aux coutumes de la guerre codifiées par le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, en présence d’un raisonnement aussi sommaire de la part des tribunaux lettons, elle conclut qu’il n’existait en droit international aucune base juridique plausible pour condamner le requérant pour avoir dirigé le commando chargé de cette opération.
138. Reste cependant la question des trois femmes tuées à Mazie Bati, à savoir la mère et l’épouse, enceinte de neuf mois, de Meikuls Krupniks, ainsi que l’épouse de Bernards Šķirmants. En l’occurrence, la Cour considère que la qualification juridique des circonstances de leur décès dépend essentiellement de deux questions : premièrement, celle de savoir si et dans quelle mesure elles avaient participé à la trahison du groupe du major Tchougounov, en février 1944, et deuxièmement, celle de savoir si leur exécution avait été initialement prévue par les partisans rouges ou s’il s’agissait plutôt d’un excès de pouvoir de la part de ces derniers. Là encore, la Cour ne peut que déplorer le caractère trop général et succinct de la motivation adoptée par les juridictions nationales, en ce qu’elle ne permet pas de répondre avec certitude à ces deux questions. Pour sa part, elle peut envisager deux versions possibles sur ce point.
139. La première version consisterait à dire que les trois villageoises concernées avaient leur part de culpabilité dans la trahison des hommes de Tchougounov, et que leur exécution était, dès le début, incluse dans le plan de l’opération du 27 mai 1944. La Cour note que le Gouvernement n’a pas réfuté l’assertion du requérant selon laquelle ces trois femmes avaient trompé la vigilance des partisans rouges réfugiés dans la grange de Meikuls Krupniks, qu’elles avaient fait le guet pendant que les hommes se rendaient au village voisin pour alerter la garnison allemande, et qu’après la mort des partisans la mère de Krupniks avait dépouillé leurs cadavres des manteaux qu’ils portaient (paragraphe 22 ci-dessus). Cette version semble confortée par le fait que seules ces femmes furent tuées, alors que, par exemple, l’épouse de Vladislavs Šķirmants fut épargnée (paragraphe 18 ci-dessus). Or, si cette version correspond à la vérité, force est à la Cour de conclure que les trois femmes avaient elles aussi abusé de leur statut de « personnes civiles » en fournissant une assistance réelle et concrète aux six hommes de Mazie Bati dans leur collaboration avec l’occupant nazi. Dans ces circonstances, le constat que la Cour vient de formuler au sujet des hommes exécutés lors de l’opération du 27 mai 1944 est, d’une manière générale, également applicable aux trois femmes en cause.
ii. Article 7 § 2
147. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le comportement du requérant lors de l’attaque de Mazie Bati « était criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens du second paragraphe de l’article 7 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que, dans pratiquement toutes les affaires où les organes de la Convention ont examiné l’affaire sous l’angle du second paragraphe de l’article 7, ils n’ont pas jugé nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain du premier paragraphe (De Becker c. Belgique, no 214/56, décision de la Commission du 9 juin 1958, Annuaire 2, p. 214 ; X. c. Norvège, no 931/60, décision de la Commission du 30 mai 1961, Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme no 6, p. 41 ; X. c. Belgique, no 1028/61, décision de la Commission du 18 septembre 1961, Annuaire no 4, p. 325, et Naletilić c. Croatie (déc.), no 51891/99, CEDH 2000-V, ainsi que les décisions X. c. Belgique (no 268/57), Touvier et Papon (no 2) précitées ; pour un raisonnement plus étendu, voir Penart c. Estonie (déc.), no 14685/04, 24 janvier 2006, et la décision Kolk et Kislyiy précitée). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette logique. Puisqu’elle a examiné l’affaire à l’aune du premier paragraphe de l’article 7, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se placer également sur le terrain du second paragraphe. En tout état de cause, à supposer même que cette disposition soit applicable en l’espèce, l’opération du 27 mai 1944 ne saurait pas non plus passer pour « criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
c) Conclusion
148. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, le 27 mai 1944, le requérant ne pouvait raisonnablement prévoir que ses actes constituaient un crime de guerre au sens du jus in bello de l’époque ; il n’existait donc en droit international aucune base juridique plausible pour le condamner pour un tel crime. A supposer toutefois que le requérant ait commis une ou plusieurs infractions de droit commun réprimées par le droit interne, celles-ci, par l’effet de la prescription, ne sont plus punissables depuis longtemps ; dès lors, le droit national ne pouvait pas non plus servir de base à sa condamnation.
149. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.
Le gouvernement letton fait appel devant la grande chambre
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE DU 17 MAI 2010
Elle (la CEDH) considère que les villageois n'étaient pas des francs-tireurs, compte tenu de la nature de leurs activités censées avoir abouti à l'attaque litigieuse et du fait que, au moment des évènements, ils ne participaient pas à des hostilités. Elle ajoute que la notion de levée en masse ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que Mazie Bati était déjà sous occupation allemande au moment des événements en question.
Existait-il en 1944 une base juridique suffisamment claire pour les crimes pour lesquels le requérant a été condamné ?
196. Le requérant a été condamné sur le fondement de l'article 68-3 du code pénal de 1961, disposition introduite par le Conseil suprême le 6 avril 1993. Tout en donnant certains exemples d'actes constitutifs de violations des lois et coutumes de la guerre, cette disposition renvoyait aux « conventions juridiques pertinentes » pour une définition précise des crimes de guerre (paragraphe 48 ci-dessus). La condamnation du requérant pour crimes de guerre était donc fondée sur le droit international et non sur le droit national, et elle doit, de l'avis de la Cour, être examinée principalement sous cet angle.
197. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il appartient d'interpréter la législation interne. Son rôle se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, et Korbely précité, § 72).
198. Toutefois, la Grande Chambre considère avec la chambre que la Cour doit jouir d'un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l'occurrence l'article 7, requiert l'existence d'une base légale pour l'infliction d'une condamnation et d'une peine. L'article 7 § 1 exige de la Cour qu'elle recherche si la condamnation du requérant reposait à l'époque sur une base légale. En particulier, elle doit s'assurer que le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes (condamnation pour crimes de guerre en vertu de l'article 68-3 de l'ancien code pénal) était en conformité avec l'article 7 de la Convention, peu important à cet égard qu'elle adopte une approche et un raisonnement juridiques différents de ceux développés par les juridictions internes. L'article 7 deviendrait sans objet si l'on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour. Aussi la Grande Chambre ne se prononcera-t-elle pas sur les diverses voies suivies par les juridictions internes inférieures, notamment celle empruntée par le tribunal régional de Latgale dans sa décision d'octobre 2003, sur laquelle le requérant s'appuie fortement, mais qui a été annulée par la division des affaires pénales. Il lui faut simplement déterminer si la décision rendue par la chambre des affaires pénales et confirmée par le sénat de la Cour suprême était compatible avec l'article 7 (Streletz, Kessler et Krenz précité, §§ 65-76).
199. En somme, la Cour doit rechercher si, compte tenu de l'état du droit international en 1944, la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire (voir, mutatis mutandis, Korbely précité, § 78).
a) Portée du statut juridique du requérant et des villageois
200. Pour les parties, comme pour les tiers intervenants et pour la chambre, le requérant peut se voir attribuer le statut juridique de « combattant ». Vu son engagement militaire en URSS et sa qualité de commandant de l'unité de partisans rouges qui était entrée à Mazie Bati (paragraphe 14 ci-dessus), il était en principe un combattant, eu égard aux critères régissant ce statut en droit international qui s'étaient cristallisés avant l'adoption du Règlement de La Haye, qui avaient été codifiés par ce règlement et qui faisaient sans conteste partie du droit international en vigueur en 1939.
201. La Grande Chambre observe qu'il n'a pas été contesté au niveau national et qu'il ne l'est pas davantage devant elle que le requérant et son unité portaient l'uniforme de la Wehrmacht au cours de l'attaque menée contre les villageois, de sorte que l'un des critères susmentionnés n'était pas rempli dans leur cas. Il pourrait en découler que le requérant avait perdu son statut de combattant (et de ce fait le droit d'attaquer).
De surcroît, le port de l'uniforme ennemi durant le combat pouvait en soi être constitutif d'une infraction. Si les tribunaux nationaux n'ont pas accusé le requérant d'un crime de guerre distinct à raison de ce fait, il reste toutefois que cet élément n'est pas sans incidence sur les autres crimes de guerre reprochés à l'intéressé (notamment ceux de meurtre et infliction de blessures par trahison, voir le paragraphe 217 ci-dessous). La Cour admettra donc que le requérant et les membres de son unité étaient des « combattants ». L'une des hypothèses admises par elle concernant les villageois décédés est qu'ils pourraient eux aussi être considérés comme des « combattants » (paragraphe 194 ci-dessus).
202. Quant aux droits attachés au statut de combattant, le jus in bello reconnaissait en 1944 aux combattants qui étaient capturés, qui se rendaient ou qui étaient mis hors de combat le droit au statut de prisonnier de guerre, et les prisonniers de guerre avaient droit à un traitement humain. Il était donc contraire au jus in bello en vigueur en 1944 d'infliger des mauvais traitements à un prisonnier de guerre ou de l'exécuter sommairement, le recours aux armes étant cependant autorisé lorsque, par exemple, un prisonnier de guerre tentait de s'évader ou d'attaquer ceux qui l'avaient capturé.
203. Quant à la protection accordée aux « civils ayant pris part aux hostilités » – l'autre hypothèse retenue concernant les villageois décédés – la Cour note qu'en 1944 la distinction entre combattants et civils (et entre les protections qui leur étaient octroyées) était l'un des fondements des lois et coutumes de la guerre, la Cour internationale de Justice (la « CIJ ») ayant décrit cette distinction comme étant l'un des deux « principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire ». Il se dégage de dispositions conventionnelles et de déclarations antérieures qu'en 1944 les « civils » étaient définis par opposition aux combattants. Par ailleurs, en vertu du droit international coutumier en vigueur en 1944, les civils ne pouvaient être attaqués que lorsqu'ils participaient directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
204. Enfin, lorsque des civils ayant pris part aux hostilités étaient soupçonnés de s'être rendus coupables de violations du jus in bello (par exemple, de trahison de guerre par communication de renseignements à l'administration militaire allemande, paragraphe 194 ci-dessus), ils pouvaient être arrêtés, jugés – dans le cadre d'un procès équitable – et punis par une juridiction militaire ou civile pour les actes en question, mais leur exécution sommaire, sans procès, était contraire aux lois et coutumes de la guerre.
b) Les crimes de guerre engageaient-ils la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs en 1944 ?
205. En 1944, on entendait par crime de guerre une violation des lois et coutumes de la guerre.
206. La Cour note ci-après les principales étapes de la codification des lois et coutumes de la guerre et de l'évolution du principe de la responsabilité pénale individuelle jusques et y compris la fin de la Seconde Guerre mondiale.
207. Si la notion de crimes de guerre est connue depuis des siècles, les actes constitutifs de crimes de guerre susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leur auteur ont commencé à faire l'objet d'une codification solide au milieu du XIXe siècle. Le Code Lieber de 1863 (paragraphes 63-77 ci-dessus) définissait un certain nombre d'infractions aux lois et coutumes de la guerre et précisait les sanctions qui s'y attachaient, et plusieurs de ses dispositions retenaient le principe d'une responsabilité pénale individuelle. D'origine américaine, ce code a constitué la première codification moderne des lois et coutumes de la guerre, et il a joué un rôle dans les conférences de codification ultérieures, notamment la conférence de Bruxelles tenue en 1874 (paragraphe 79 ci-dessus). Le Manuel d'Oxford de 1880 proscrivait quant à lui une multitude d'actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et énonçait expressément que « les violateurs des lois de la guerre [étaient] passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale ». Ces premières codifications, et en particulier le projet de Déclaration de Bruxelles, ont à leur tour inspiré la Convention et le Règlement de La Haye de 1907. Ce sont ces deux derniers instruments qui ont été les plus marquants dans le processus de codification. En 1907, ils étaient déclaratifs des lois et coutumes de la guerre : ils définissaient notamment des notions clés pertinentes (combattants, levée en masse, hors de combat), énuméraient en détail les infractions aux lois et coutumes de la guerre et assuraient, par le biais de la Clause de Martens, une protection résiduelle aux populations et aux belligérants dans les cas non couverts par l'une de leurs dispositions. Ces textes posaient en principe la responsabilité des Etats, qui devaient donner à leurs forces armées des instructions conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre et verser une indemnité en cas de violation par des membres de leurs forces des dispositions dudit Règlement.
L'impact qu'avait eu la Première Guerre mondiale sur la population civile a entraîné l'insertion dans les Traités de Versailles et de Sèvres de dispositions sur la responsabilité, le jugement et le châtiment des criminels de guerre présumés. Les travaux de la Commission internationale de 1919 (après la Première Guerre mondiale) et de l'UNWCC (durant la Seconde Guerre mondiale) ont beaucoup contribué à la consolidation du principe de la responsabilité pénale individuelle dans le droit international. Le « droit de Genève » (notamment les conventions de 1864, 1906 et 1929, paragraphes 53-62 ci-dessus) protégeait les victimes de la guerre et fournissait des garanties aux membres des forces armées réduits à l'impuissance et aux personnes ne prenant pas part aux hostilités. Le droit de La Haye et celui de Genève sont étroitement liés, le second complétant le premier.
Le Statut du TMI de Nuremberg définissait de manière non limitative les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Dans son jugement, le tribunal émit l'opinion que les règles humanitaires qui figuraient dans la Convention et le Règlement de La Haye de 1907 étaient « admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l'expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre » qui étaient applicables en 1939 et que les violations de ces textes constituaient des crimes dont les auteurs devaient être punis. La doctrine reconnaissait à l'époque que le droit international définissait déjà les crimes de guerre et exigeait que des poursuites fussent engagées contre leurs auteurs. Le Statut du TMI de Nuremberg n'était donc pas une législation pénale ex post facto. Quant aux « principes de Nuremberg », dégagés ultérieurement du Statut et du jugement du TMI de Nuremberg, ils réitéraient la définition de la notion de crimes de guerre qui avait été énoncée dans le Statut et le principe selon lequel tout auteur d'un acte constitutif d'un crime de droit international est responsable de ce chef et passible d'un châtiment.
208. Tout au long de cette période de codification, les lois et coutumes de la guerre furent surtout appliquées par les juridictions pénales et militaires nationales, les poursuites internationales par le biais des TMI revêtant un caractère exceptionnel. Le jugement du TMI de Nuremberg reconnut du reste explicitement que les juridictions internes continuaient d'avoir un rôle à jouer en la matière. Par conséquent, l'avènement de la responsabilité internationale des Etats fondée sur les traités et conventions n'avait pas supprimé l'obligation que le droit coutumier faisait peser sur les Etats de poursuivre et punir, par l'entremise de leurs juridictions pénales et militaires, les individus s'étant rendus coupables de violations des lois et coutumes de la guerre. Tant le droit international que le droit national (celui-ci incluant les normes internationales transposées) servaient de base aux poursuites et à la détermination de la responsabilité au niveau national. En particulier, lorsque le droit national ne définissait pas les éléments constitutifs d'un crime de guerre, le tribunal national pouvait se fonder sur le droit international pour étayer son raisonnement, sans enfreindre les principes nullum crimen et nulla poena sine lege.
209. Quant à la pratique de ces tribunaux nationaux, la Cour relève que si la répression des crimes de guerre était prévue par les ordres juridiques et les manuels militaires de bon nombre d'Etats avant la Première Guerre mondiale, très peu de ces Etats poursuivaient leurs propres criminels de guerre, les cours martiales américaines tenues aux Philippines constituant une exception notable et instructive, tout comme les procès de Leipzig et les procès turcs organisés après la Première Guerre mondiale. Enfin, la volonté de poursuivre les auteurs de crimes de guerre commis à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale s'est manifestée très tôt après le déclenchement de celle-ci et, parallèlement aux poursuites internationales, le principe d'une poursuite des criminels de guerre devant les juridictions internes fut maintenu. C'est ainsi qu'outre les poursuites devant le TMI de Nuremberg, des procès internes concernant des crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale eurent lieu dans différents pays, notamment en URSS, pendant la Seconde Guerre mondiale et immédiatement après son dénouement. Certains de ces procès méritent d'être signalés en ce qu'ils ont traité de manière approfondie des principes pertinents des lois et coutumes de la guerre, en particulier concernant l'obligation d'accorder un procès équitable aux combattants et aux civils soupçonnés de crimes de guerre.
211. La Cour voit dans le principe de la responsabilité individuelle des commandants un mode de responsabilité pénale qui permet de sanctionner un supérieur ayant manqué à son devoir d'exercer son autorité, et non un mode de responsabilité reposant sur le fait d'autrui. La notion de responsabilité pénale pour les actes de subordonnés découle de deux règles coutumières établies de longue date qui veulent, premièrement, qu'un combattant soit commandé par un supérieur et, deuxièmement, qu'il obéisse aux lois et coutumes de la guerre (paragraphe 200 ci-dessus). La responsabilité pénale individuelle pour les actes accomplis par des subordonnés fut retenue dans certains procès menés avant la Seconde Guerre mondiale, dans certains instruments de codification, dans des déclarations faites par des Etats pendant et immédiatement après cette guerre et dans des procès (nationaux et internationaux) pour des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette responsabilité a depuis été confirmée comme principe du droit international coutumier et elle est systématiquement inscrite dans les Statuts des tribunaux internationaux.
212. Enfin, lorsque le droit international ne définissait pas avec une clarté suffisante les sanctions s'attachant à tel ou tel crime de guerre, un tribunal national pouvait, après avoir jugé un accusé coupable, fixer la peine sur la base du droit pénal interne.
213. Dès lors, la Cour considère qu'en mai 1944 les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, que le droit international exposait les principes fondamentaux sous-jacents à cette incrimination et qu'il donnait une large série d'exemples d'actes constitutifs de crimes de guerre. Les Etats avaient pour le moins l'autorisation (sinon l'obligation) de prendre des mesures pour punir les individus coupables de tels crimes, y compris sur la base du principe de la responsabilité des commandants. C'est ainsi que des tribunaux internationaux et nationaux ont, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, poursuivi des soldats pour des crimes de guerre commis durant ce conflit.
c) Les crimes de guerre pour lesquels le requérant a été condamné
214. La Cour examinera donc s'il existait à l'époque une base légale suffisamment claire pour les crimes de guerre spécifiques pour lesquels le requérant a été condamné. Pour ce faire, elle se fondera sur les principes généraux décrits ci-dessous.
215. Elle rappelle que, dans l'affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a déclaré que les obligations de faire connaître l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales et d'en avertir les navires s'en approchant étaient fondées non pas sur la huitième Convention de La Haye de 1907, qui était applicable en temps de guerre, mais sur certains « principes généraux et bien reconnus », tels que, en premier lieu, « des considérations élémentaires d'humanité », plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre. Dans l'avis consultatif « Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires » rendu par elle ultérieurement, la CIJ s'est référée aux deux « principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire » : le premier, mentionné ci-dessus, était le principe de distinction, destiné à « protéger la population civile et les biens de caractère civil », et, selon le second, « il ne [fallait] pas causer des maux superflus aux combattants ». S'appuyant expressément sur la Clause de Martens, la CIJ a fait remarquer que c'était sans doute parce qu'un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés étaient si fondamentales pour « le respect de la personne humaine » et pour des « considérations élémentaires d'humanité » que les Conventions de La Haye et de Genève étaient devenues « des principes intransgressibles du droit international coutumier » dès le procès de Nuremberg. Ces principes, y compris la Clause de Martens, constituaient pour elle des normes juridiques à l'aune desquelles les tribunaux devaient apprécier les actes accomplis dans un contexte de guerre.
216. La Cour note premièrement que les juridictions pénales nationales se sont principalement fondées sur les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 (paragraphes 60-62 ci-dessus) pour condamner le requérant pour avoir infligé aux villageois des mauvais traitements, des blessures, puis la mort. Elle estime, eu égard notamment à l'article 23 c) du Règlement de La Haye de 1907, que, même à admettre que les villageois décédés étaient des combattants ou des civils ayant participé aux hostilités, il se dégageait du jus in bello tel qu'il existait en 1944 que les actes en question étaient contraires à une règle fondamentale des lois et coutumes de la guerre qui protégeait les ennemis hors de combat et donc constitutifs d'un crime de guerre. Pour bénéficier de cette protection, un individu devait être blessé, réduit à l'impuissance ou être incapable de se défendre pour une autre raison (et ne pas porter d'armes), il ne devait pas nécessairement jouir d'un statut juridique particulier ni s'être formellement rendu. Comme combattants, les villageois auraient par ailleurs eu droit à une protection en tant que prisonniers de guerre tombés au pouvoir du requérant et de son unité, et leur traitement et leur exécution sommaire ultérieure auraient été contraires aux nombreuses règles et coutumes de la guerre protégeant les prisonniers de guerre (paragraphe 202 ci-dessus). Dès lors, l'infliction aux villageois de mauvais traitements, de blessures, puis de la mort était constitutive d'un crime de guerre.
217. Deuxièmement, la Cour estime que c'est à bon droit que les juridictions nationales se sont appuyées sur l'article 23 b) du Règlement de La Haye de 1907 pour fonder une condamnation distincte pour infliction de blessures et de la mort par trahison. A l'époque des faits, la trahison et la perfidie étaient des notions proches, et les blessures ou la mort étaient réputées avoir été infligées par trahison si l'auteur avait fait croire à l'ennemi par des procédés illicites, par exemple le port indu de l'uniforme ennemi, qu'il n'était pas sous la menace d'une attaque. Ainsi que la Cour l'a noté aux paragraphes 16 et 201 ci-dessus, le requérant et son unité portaient effectivement l'uniforme allemand durant l'opération conduite à Mazie Bati. L'article 23 b) était manifestement applicable si les villageois étaient considérés comme des « combattants » et il pouvait aussi s'appliquer s'ils étaient considérés comme des civils ayant participé aux hostilités. Cette disposition interdisait de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie, expression qui pouvait être interprétée comme englobant toutes les personnes soumises d'une manière ou d'une autre au pouvoir d'une armée hostile, y compris la population civile d'un territoire occupé.
218. Troisièmement, les tribunaux lettons se sont appuyés sur l'article 16 de la quatrième Convention de Genève de 1949 pour conclure que le fait d'avoir brûlé vive une femme enceinte, au mépris de la protection spéciale accordée aux femmes, était constitutif d'un crime de guerre. Enoncé par des instruments aussi anciens que le Code Lieber de 1863 (articles 19 et 37), le principe selon lequel les femmes, a fortiori lorsqu'elles sont enceintes, doivent faire l'objet d'une protection particulière en temps de guerre faisait partie des lois et coutumes de la guerre à l'époque pertinente. Il a été renforcé par le « droit de Genève » sur les prisonniers de guerre (en raison de la vulnérabilité particulière des femmes se trouvant dans cette situation). La Cour estime que ces différentes expressions de la « protection spéciale » accordée aux femmes, combinées avec la protection prévue par la Clause de Martens (paragraphes 86-87 et 215 ci-dessus), sont suffisantes pour conclure que la condamnation du requérant pour un crime de guerre distinct à raison du meurtre de Mme Krupniks, qui fut brûlée vive, reposait sur une base légale plausible. Elle voit une confirmation de ce point de vue dans les nombreuses protections spéciales spécifiquement accordées aux femmes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale dans les première, deuxième et quatrième Conventions de Genève de 1949, notamment à l'article 16 de la quatrième Convention.
219. Quatrièmement, les juridictions internes se sont fondées sur l'article 25 du Règlement de La Haye de 1907, qui proscrivait les attaques de localités non défendues. Cet article s'inscrivait dans un ensemble de dispositions analogues du droit international (notamment l'article 23 g) du Règlement de La Haye de 1907), qui interdisaient les destructions de biens privés non « impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ». Il n'a pas été prouvé au niveau national, ni d'ailleurs soutenu devant la Cour, que l'incendie de la ferme à Mazie Bati eût été ainsi commandé.
220. Cinquièmement, si diverses dispositions de la Convention de La Haye de 1907, de la quatrième Convention de Genève de 1949 et du Protocole additionnel de 1977 ont été invoquées au niveau national en ce qui concerne les accusations de pillage (vols de vêtements et de nourriture), les juridictions internes n'ont pas conclu formellement que pareils vols eussent été commis.
221. Enfin, la Cour ajoutera que, même à admettre que les villageois (quelque statut juridique qu'on leur attribue) aient commis des crimes de guerre, en 1944 le droit international coutumier n'autorisait le requérant et son unité qu'à arrêter les villageois et, après seulement le prononcé d'une condamnation à l'issue d'un procès équitable, à exécuter le châtiment infligé (paragraphe 204 ci-dessus). Ainsi que le gouvernement défendeur l'a fait observer dans la version des événements qu'il a fournie devant la chambre (paragraphes 21-24 ci-dessus) et qu'il réitère devant la Grande Chambre (paragraphe 162 ci-dessus), le requérant décrit en réalité ce qu'il aurait dû faire (arrêter les villageois en vue de leur jugement). Quoi qu'il en soit, qu'un tribunal de partisans ait prononcé ou non un jugement (paragraphe 132 de l'arrêt de la chambre), on ne saurait qualifier d'équitable un procès tenu en l'absence des villageois accusés, à leur insu ou sans leur participation, et suivi de leur exécution.
222. Estimant que les actes susmentionnés commis par le requérant pouvaient s'analyser en crimes de guerre en 1944 (Streletz, Kessler et Krenz précité, § 76), la Cour juge qu'il n'y a pas lieu d'aborder les autres accusations retenues contre lui.
223. En outre, le sénat de la Cour suprême a noté que la chambre des affaires pénales avait établi, sur la base de preuves, que le requérant avait organisé, commandé et dirigé l'unité de partisans qui, entre autres, avait tué les villageois et détruit les fermes, et que ces actes avaient été prémédités. S'appuyant sur l'article 6 du Statut du TMI de Nuremberg, il a jugé ces éléments suffisants pour faire peser sur le requérant la responsabilité du commandement pour les actes de l'unité. En particulier, les faits établis indiquaient que l'intéressé avait dirigé de jure et de facto l'unité. Compte tenu du but de la mission, tel qu'établi au niveau interne, le requérant avait l'intention criminelle (mens rea) requise. D'ailleurs, les propres observations de l'intéressé devant la Grande Chambre (selon lesquelles son unité n'aurait pas pu arrêter les villageois, étant donné notamment sa mission et la situation de combat, paragraphe 162 ci-dessus) cadrent pleinement avec les faits susmentionnés établis par la chambre des affaires pénales. Eu égard à la responsabilité qui incombait au requérant en sa qualité de commandant, il n'y a pas lieu de rechercher si les juridictions internes auraient légitimement pu conclure que le requérant avait personnellement commis un des actes perpétrés à Mazie Bati le 27 mai 1944 (paragraphe 141 de l'arrêt de la chambre).
224. Enfin, la Cour tient à clarifier deux derniers points.
225. Le gouvernement défendeur soutient que les actes du requérant ne peuvent passer pour des représailles légales d'un belligérant. Ni le requérant ni le gouvernement de la Fédération de Russie n'ont répondu en substance à cet argument. Les juridictions internes ont certes considéré que l'intéressé avait mené l'opération de Mazie Bati à titre de « représailles », mais il est clair que si la légalité de ces représailles a été plaidée devant elles, elles n'ont pas accepté ce moyen. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l'appréciation portée par les tribunaux internes à cet égard (que l'on considère les villageois comme des combattants ou des civils ayant participé aux hostilités).
226. Quant au paragraphe 134 de l'arrêt de la chambre, la Grande Chambre estime, avec le gouvernement défendeur, que l'on ne peut se défendre d'une accusation de crimes de guerre en plaidant que d'autres ont aussi commis pareils crimes, à moins que ces actes imputés aux autres aient revêtu un caractère, une ampleur et une régularité propres à attester un changement dans la coutume internationale.
227. En conclusion, à supposer même que l'on puisse considérer que les villageois décédés étaient des « civils ayant participé aux hostilités » ou des « combattants » (paragraphe 194 ci-dessus), la condamnation et la sanction infligées au requérant pour des crimes de guerre commis en sa qualité de commandant de l'unité responsable de l'attaque menée à Mazie Bati le 27 mai 1944 reposaient sur une base légale suffisamment claire eu égard à l'état du droit international en 1944. La Cour ajoute que si les villageois avaient été considérés comme des « civils » ils auraient eu droit par le fait même à une protection encore supérieure.
5. Les accusations de crimes de guerre étaient-elles prescrites ?
231. Toutefois, en 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure sur la responsabilité pour crimes de guerre et l'obligation de les poursuivre et de les réprimer il n'avait été prévu de délais de prescription. Si l'article II § 5 de la Loi no 10 du Conseil de contrôle traitait la question relativement aux crimes de guerre commis sur le territoire allemand avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo, la Convention de 1948 sur le génocide, les Conventions de Genève de 1949 et les Principes de Nuremberg ne prévoyaient rien concernant la prescriptibilité des crimes de guerre (comme le confirme le préambule de la Convention de 1968).
232. La question essentielle devant être tranchée par la Cour est donc de savoir si, à quelque moment que ce soit avant l'engagement des poursuites contre le requérant, pareilles poursuites devaient être réputées prescrites en vertu du droit international. Il ressort du paragraphe précédent qu'en 1944 aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre, et dans son évolution postérieure à 1944 le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits.
233. En résumé, la Cour estime, premièrement, qu'aucune des dispositions du droit interne relatives à la prescription n'était applicable (paragraphe 230 ci-dessus) et, deuxièmement, que les accusations portées contre le requérant n'ont jamais été prescrites en vertu du droit international (paragraphe 232 ci-dessus). Elle conclut donc que les poursuites dirigées contre le requérant n'étaient pas prescrites.
6. Le requérant pouvait-il prévoir que les actes en cause s'analyseraient en des crimes de guerre et qu'il serait poursuivi ?
234. Le requérant soutient en outre qu'il ne pouvait pas prévoir que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre et qu'il serait poursuivi ultérieurement.
Il plaide premièrement qu'il n'était en 1944 qu'un jeune soldat placé dans une situation de combat derrière les lignes ennemies et détaché du contexte international décrit ci-dessus et que, dans ces conditions, il ne pouvait prévoir que les actes pour lesquels il a été condamné s'analyseraient en des crimes de guerre. Il soutient deuxièmement qu'il était politiquement imprévisible qu'il serait poursuivi : sa condamnation après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991 aurait été un acte politique de la part de l'Etat letton et elle n'aurait pas répondu à un véritable souhait de ce pays de respecter son obligation internationale de poursuivre les criminels de guerre.
235. Concernant le premier point, la Cour estime qu'eu égard au contexte, qui est celui du comportement d'un officier commandant au regard des lois et coutumes de la guerre, les notions d'accessibilité et de prévisibilité doivent être examinées conjointement.
Elle rappelle en outre que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Les professionnels doivent faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).
236. Quant au point de savoir si l'on peut considérer que, nonobstant le fait qu'elle était exclusivement fondée sur le droit international, la qualification des actes litigieux en crimes de guerre était suffisamment accessible et prévisible pour le requérant en 1944, la Cour rappelle qu'elle a précédemment estimé que la responsabilité pénale individuelle d'un simple soldat (garde-frontière) était définie avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par, notamment, l'obligation de respecter les instruments internationaux des droits de l'homme, même si ceux-ci, dont un n'avait du reste pas été ratifié par l'Etat en cause à l'époque des faits, ne permettaient pas d'inférer une responsabilité pénale individuelle du requérant (K.-H.W. précité, §§ 92-105). La Cour considère que même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière flagrante non seulement les propres principes légaux de son pays, mais aussi les droits de l'homme sur le plan international et, surtout, le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme (K.-H.W. précité, § 75).
237. Il est vrai que (à la différence de l'affaire K.-H.W. c. Allemagne) le code pénal de 1926 ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes internationales de la guerre et que (à la différence de l'affaire Korbely précitée, §§ 74-75) ces lois et coutumes internationales n'avaient pas fait l'objet d'une publication officielle en URSS ou en RSS de Lettonie. Toutefois, cet aspect ne saurait être décisif. Il ressort en effet clairement des conclusions formulées aux paragraphes 213 et 227 ci-dessus que les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle du requérant.
238. La Cour note en outre qu'en 1944 ces lois constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s'adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Le requérant en l'espèce était sergent dans l'armée soviétique, et il était affecté au régiment de réserve de la division lettonne : à l'époque des faits, il était membre d'une unité de commando et à la tête d'un peloton qui avait pour activités principales le sabotage militaire et la propagande. Etant donné sa position de commandant militaire, la Cour estime qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il appréciât avec un soin particulier les risques que comportait l'opération de Mazie Bati. Elle considère, eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux neuf villageois dans les circonstances, établies, de l'opération menée le 27 mai 1944 (paragraphes 15-20 ci-dessus), que même la réflexion la plus superficielle du requérant aurait indiqué à l'intéressé qu'à tout le moins les actes en cause risquaient d'enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu'elles étaient interprétées à l'époque et, spécialement, d'être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.
239. Pour ces motifs, la Cour juge raisonnable de conclure que le requérant pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient qualifiés de crimes de guerre.
240. Quant au second point soulevé par le requérant, la Cour note que la Lettonie a proclamé son indépendance en 1990 et 1991, que la nouvelle république de Lettonie a immédiatement adhéré aux divers instruments de protection des droits de l'homme (notamment à la Convention de 1968 en 1992) et qu'en 1993 elle a inséré l'article 68 § 3 dans le code pénal de 1961.
241. Elle rappelle qu'il est légitime et prévisible qu'un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l'on ne saurait reprocher aux juridictions d'un tel Etat successeur d'appliquer et d'interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque des faits sous le régime antérieur. Cela vaut en particulier lorsque la question litigieuse concerne le droit à la vie, valeur suprême dans la Convention et dans l'échelle des droits de l'homme au plan international, que les Etats contractants ont l'obligation primordiale de protéger en application de la Convention. Tout comme les lois et coutumes de la guerre font obligation aux Etats d'engager des poursuites, l'article 2 de la Convention astreint les Etats à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale dissuadant les individus de commettre des atteintes contre la vie des personnes (Streletz, Kessler et Krenz, §§ 72 et 79-86, et K.-H.W., §§ 66 et 82-89, tous deux précités). Il suffit, aux fins de la présente espèce, de noter que les principes susmentionnés sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après les déclarations d'indépendance de 1990 et 1991 (paragraphes 27-29 et 210 ci-dessus).
242. Quant à l'appui des autorités soviétiques dont le requérant aurait toujours bénéficié après 1944, la Cour estime que cet argument est sans rapport avec la question juridique de savoir si l'intéressé pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre.
243. En conséquence, la Cour considère que les poursuites dirigées contre le requérant (et la condamnation ultérieure de l'intéressé) par la république de Lettonie sur le fondement du droit international en vigueur à l'époque de la commission des actes litigieux n'étaient pas imprévisibles.
244. A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, à l'époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d'infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre.
D. Conclusion de la Cour
245. Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la Cour estime que la condamnation du requérant pour crimes de guerre n'a pas emporté violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
246. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette condamnation sous l'angle de l'article 7 § 2.
La CEDH considère que les crimes de guerre ont été suffisamment définis par la coutume et la convention d'Amsterdam de 1907. Il s'agit d'ailleurs des textes sur lesquels le tribunal de Tokyo et le tribunal de Nuremberg se sont fondés pour condamner les dirigeants nazis et japonais.
Elle considère que si le requérant n'a pas commis d'action direct il est commandant et pénalement responsable de ses hommes qu'il n'a pas sanctionné conformément à la coutume et à la convention d'Amsterdam 1907.
Elle considère que les crimes de guerre ne sont jamais prescrits.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES ROZAKIS, TULKENS, SPIELMANN ET JEBENS
Ils considèrent que la question de la prescriptibilité à laquelle la Grande Chambre a répondu ne fait pas partie du champ d'application de l'article 7 mais est d'ordre technique au sens de l'article 6 de la Convention. Frédéric Fabre partage cette opinion puisque l'article 7 ne concerne pas la prescription.
1. Si nous suivons pleinement la majorité lorsqu'elle estime que les griefs du requérant ne peuvent pas donner lieu à un constat de violation de l'article 7 de la Convention, il est un point particulier de son raisonnement auquel nous ne pouvons souscrire : celui relatif à sa conclusion au sujet de l'argument du gouvernement de la Fédération de Russie suivant lequel il faudrait voir dans les poursuites dirigées contre l'intéressé une application rétroactive du droit pénal.
2. En effet, le gouvernement de la Fédération de Russie, partie intervenante dans la présente affaire, considérait que, compte tenu du délai de prescription maximum prévu par l'article 14 du code pénal de 1926, les poursuites contre le requérant étaient prescrites au moins depuis 1954. Il notait que le requérant avait été condamné sur le fondement de l'article 68 § 3 du code pénal de 1961 et que l'article 6 § 1 de ce code énonçait que les crimes de guerre, entre autres, étaient imprescriptibles. Dès lors, il soutenait, tout comme l'intéressé, que les poursuites intentées contre le requérant s'analysaient en une extension ex post facto du délai de prescription qui aurait été applicable au niveau national en 1944 et, par conséquent, en une application rétroactive du droit pénal (paragraphes 228 et 229 de l'arrêt).
3. La réponse de la Cour est donnée dans les paragraphes 230 et 233 de l'arrêt qui expliquent, en substance, que ce n'est pas le code pénal de 1926 (qui intégrait une disposition relative à la prescriptibilité) qui aurait constitué le fondement de la responsabilité du requérant en 1944 si l'intéressé avait été poursuivi pour crimes de guerre en Lettonie en 1944. S'appuyant sur la manière dont le code en question était libellé, la Cour indique que « des poursuites pour crimes de guerre au niveau national en 1944 auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable ». Toutefois, elle poursuit ainsi : « en 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure sur la responsabilité pour crimes de guerre et l'obligation de les poursuivre et de les réprimer il n'avait été prévu de délais de prescription (...) les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo, la Convention de 1948 sur le génocide, les Conventions de Genève de 1949 et les Principes de Nuremberg ne prévoyaient rien concernant la prescriptibilité des crimes de guerre (comme le confirme le préambule de la Convention de 1968) ». L'absence de toute évocation de la question de la prescriptibilité dans les instruments adoptés après la guerre amène la Cour à conclure que les crimes commis par le requérant étaient imprescriptibles en vertu du droit international, qui était silencieux en la matière : en 1944 aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre et, dans son évolution postérieure à 1944, le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits.
4. A notre sens, la réponse donnée par la Cour sur ce point particulier n'est pas la bonne. Le simple silence du droit international ne suffit pas à prouver que le consentement et les intentions de la communauté internationale en 1944 étaient claires relativement à l'imprescriptibilité des crimes de guerre, en particulier si l'on tient compte du fait qu'avant Nuremberg et Tokyo l'état du droit pénal international concernant la responsabilité individuelle pour crimes de guerre n'avait pas encore atteint un degré de sophistication et d'exhaustivité permettant de conclure que les questions techniques et procédurales relatives à l'application de ce droit avaient été clairement tranchées. En substance, on pourrait dire qu'en 1944 le droit international général – appréhendé comme une combinaison des accords internationaux généraux existants et de la pratique des Etats – avait résolu la question de la responsabilité individuelle (et pas seulement celle de la responsabilité des Etats), et que ce n'est qu'après la guerre que furent précisées les questions procédurales, telles que celle de la prescriptibilité des crimes de guerre.
5. Pourtant, il nous semble que la Cour a traité à tort la question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre du requérant en 1944 comme un aspect distinct des exigences de l'article 7. L'impression créée par cette réponse donnée à un argument soulevé par les parties est que le lien établi par celles-ci entre (im)prescriptibilité des crimes de guerre et rétroactivité du droit les régissant est légitime, et que la Cour s'est bornée à chercher à démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, les crimes reprochés étaient déjà imprescriptibles.
6. Ce n'est pas la bonne approche. Le point de départ, selon nous, réside dans le fait que l'article 7 de la Convention et les principes qu'il consacre exigent que, dans un ordre juridique fondé sur l'Etat de droit, un justiciable qui envisage d'accomplir un acte déterminé puisse, en se reportant aux normes définissant les incriminations et les sanctions correspondantes, déterminer le caractère infractionnel ou non de cet acte et la peine qu'il risque de se voir infliger s'il l'accomplit. Partant, on ne peut parler d'application rétroactive du droit matériel lorsqu'une personne est condamnée, même tardivement, sur le fondement de dispositions qui étaient en vigueur au moment de la commission de l'acte. Considérer, comme la Cour le laisse entendre, que la question procédurale de la prescriptibilité fait partie intégrante de l'applicabilité de l'article 7, qu'elle est liée à la question de l'application rétroactive et qu'elle a le même poids que la condition d'existence d'une incrimination et d'une peine peut aboutir à des résultats indésirables de nature à affaiblir l'esprit même de l'article 7.
7. Il fallait, bien sûr, répondre aux arguments des parties concernant la prescriptibilité, mais en envisageant celle-ci comme une question purement technique, davantage liée à l'équité de la procédure et à l'article 6 de la Convention. A notre sens, s'il est vrai que la question de la prescriptibilité n'était pas forcément résolue en 1944 – bien que le requérant ne puisse pas tirer avantage d'une telle lacune – il reste que l'évolution ultérieure, après la Seconde Guerre mondiale, démontre clairement que la communauté internationale a non seulement consolidé sa position en condamnant vigoureusement les crimes de guerre haineux, mais a progressivement formulé des règles détaillées – notamment procédurales – régissant la façon dont ces crimes devraient être traités par le droit international. Ces développements constituent une chaîne continue de production juridique, qui laisse peu de place à l'idée que l'ordre juridique international n'était pas prêt à poursuivre et condamner les crimes commis durant la guerre. Certes, à ce stade, le silence sur la question de la prescriptibilité était total, comme le démontre aussi l'adoption de la Convention de 1968, qui « proclamait » l'imprescriptibilité de ces crimes. C'est précisément cette série d'événements qui a permis à l'Etat letton de poursuivre et de punir le requérant pour ses crimes.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE COSTA, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES KALAYDJIEVA ET POALELUNGI
1. Nous avons considéré, à l'instar de la majorité de la chambre et contrairement à la majorité de la Grande Chambre, que l'article 7 de la Convention a été méconnu par l'Etat défendeur du fait de la poursuite et de la condamnation du requérant pour crimes de guerre. Nous allons nous efforcer d'exposer notre position sur ce point.
2. Une observation préliminaire s'impose, qui se rattache à la structure même de l'article 7 de la Convention.
3. Comme on le sait, le premier des deux paragraphes de cet article pose de façon générale le principe de la légalité des délits et des peines, qui implique notamment leur non-rétroactivité ; le second paragraphe (lex specialis en quelque sorte) déroge au précédent, lorsque l'action ou l'omission était, au moment où elle a été commise, criminelle d'après « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». (Cette expression est celle-là même qui est utilisée à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui l'a évidemment inspirée.)
4. La Grande Chambre a, à juste titre, rappelé au paragraphe 186 de l'arrêt, en citant la décision Tess c. Lettonie (no 34854/02, du 12 décembre 2002), qu'il faut interpréter de façon concordante les deux paragraphes de l'article 7. De même, l'arrêt a eu à notre sens raison, aux paragraphes 245 et 246, de conclure que, puisque la condamnation du requérant n'emportait pas violation de l'article 7 § 1, il n'y avait pas lieu d'examiner cette condamnation sous l'angle de l'article 7 § 2. En réalité, les raisonnements à suivre, non seulement doivent être concordants, mais ils sont étroitement liés. Il faut en effet, si on écarte la base juridique de l'incrimination selon le droit national, recourir au droit international conventionnel ou coutumier. Et si celui-ci n'offre pas non plus un fondement suffisant, l'article 7 est méconnu dans son ensemble.
5. En ce qui concerne les faits, ainsi que notre collègue Egbert Myjer l'a rappelé dans son opinion concordante jointe à l'arrêt de violation de la chambre, en principe et sauf arbitraire avéré, notre Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. Elle n'est pas une juridiction de quatrième instance, ni d'ailleurs une juridiction pénale internationale. Elle n'a pas à rejuger le requérant pour les faits survenus le 27 mai 1944 à Mazie Bati. Une décision de la Cour, rendue le 20 septembre 2007, qui revêt un caractère définitif, a écarté le grief tiré par le requérant de la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention. Le débat sur le fond de l'affaire se circonscrit donc à l'article 7, comme le dit la Grande Chambre au paragraphe 184 de l'arrêt. Mais à cet égard, et sans se substituer aux juridictions internes, la Cour doit exercer son contrôle sur l'application qui a été faite de ces dispositions conventionnelles, donc sur la légalité et la non-rétroactivité des sanctions pénales infligées au requérant. On sait d'ailleurs que, eu égard à la gravité des chefs d'accusation retenus, ces sanctions n'ont pas été très lourdes, à cause de l'âge du requérant, et du fait qu'il était infirme et inoffensif (paragraphe 39 de l'arrêt) ; mais la clémence à l'égard de l'accusé est sans influence directe sur le bien-fondé du grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Convention.
6. La première question est celle du droit national. A l'époque des faits, le code pénal soviétique de 1926, rendu applicable au territoire letton par un décret du 6 novembre 1940 (paragraphe 41 de l'arrêt), ne prévoyait pas l'incrimination de crimes de guerre en tant que tels. Ce code a été remplacé le 6 janvier 1961 par le code pénal de 1961, postérieur aux faits, et c'est une loi du 6 avril 1993, adoptée après la restauration en 1991 de l'indépendance de la Lettonie, qui a ajouté au code de 1961 des dispositions réprimant les crimes de guerre, permettant l'application rétroactive du droit pénal contre ces crimes et les déclarant imprescriptibles (articles 6-1, 45-1 et 68-3 ajoutés au code de 1961, paragraphes 48-50 de l'arrêt). Il est dans ces conditions difficile de trouver une base juridique nationale existant à l'époque des faits et, si nous comprenons bien l'arrêt, et notamment ses paragraphes 196 à 227, ce n'est que par le biais du renvoi au droit international que la majorité trouve cette base juridique, même en tenant compte de l'intervention de la loi de 1993 (voir spécialement le paragraphe 196). Cette approche est d'ailleurs aussi celle des juridictions internes, du moins du sénat de la Cour suprême dans son arrêt du 28 septembre 2004, qui est la dernière décision interne définitive. Cette décision se fonde en effet, à titre principal, sur l'article 6, deuxième alinéa point b), du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, ainsi que sur la Convention des Nations unies de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (pour l'analyse de la décision du sénat de la Cour suprême, voir le paragraphe 40 de l'arrêt).
7. La question de la base juridique en droit international est cependant beaucoup plus complexe. Elle soulève en effet de nombreuses difficultés : celle de l'existence même de cette base juridique, celle, le cas échéant, de la prescription ou au contraire de l'imprescriptibilité des accusations de crimes de guerre portées contre le requérant, celle, enfin, de la prévisibilité et de la possibilité de prévision, par le requérant, des poursuites qui furent engagées contre lui (à partir de 1998) et des condamnations prononcées à son encontre (en dernier ressort en 2004).
8. Il faut, nous semble-t-il, distinguer le droit international tel qu'il existait au moment des faits, et celui qui s'est dégagé et progressivement affirmé postérieurement, essentiellement à partir du procès de Nuremberg qui commença en novembre 1945, et qui a revêtu et revêt une importance à bien des égards capitale.
9. L'arrêt procède, et il faut le saluer, à une analyse longue et minutieuse du droit international humanitaire, et spécialement du jus in bello, avant 1944. Il est exact que ce droit s'est développé, à la fois sur le plan conventionnel et sur le plan coutumier, notamment à partir du « Code Lieber » de 1863, puis de la Convention et du Règlement de La Haye de 1907. On peut aussi faire référence à la déclaration, ou « clause » de Martens, insérée dans le préambule de la deuxième Convention de La Haye de 1899 et reprise dans celui de la Convention de La Haye de 1907 (paragraphes 86 et 87 de l'arrêt).
10. Nous ne sommes toutefois pas convaincus, même en les regardant en 2010, à l'aune d'une longue et positive évolution ultérieure, que ces textes aient pu fonder, en 1944, une base juridique suffisamment solide et reconnue pour que les crimes de guerre soient considérés comme définis à cette époque avec précision, et que leur incrimination ait pu être prévisible. Comme le note à bon droit le juge Myjer dans son opinion concordante précitée, tous les crimes commis pendant les guerres ne sont pas des « crimes de guerre » ; le droit pénal doit être rigoureux, et la Cour a souvent relevé qu'on ne peut appliquer la loi pénale au détriment d'un accusé de matière extensive, notamment par analogie, car ce serait contraire au principe nullum crimen, nulla poena sine lege (voir, par exemple, l'arrêt Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). Le requérant a été poursuivi, jugé et condamné plus d'un demi-siècle après les faits, sur la base d'une loi pénale qui aurait existé à l'époque de ceux-ci, ce qui pose à l'évidence problème.
11. Certes, l'arrêt cite aussi, aux paragraphes 97 à 103, des pratiques, antérieures à la Seconde Guerre mondiale, de poursuites pour violations des lois de la guerre (les cours martiales américaines pour les Philippines, les procès de Leipzig, les poursuites menées contre des agents de la Turquie). Ces exemples isolés et embryonnaires sont loin de révéler l'existence d'un droit coutumier suffisamment établi. Nous souscrivons plus volontiers à l'opinion exprimée par le professeur Georges Abi-Saab et Mme Rosemary Abi-Saab dans leur chapitre intitulé « les crimes de guerre » de l'ouvrage collectif « Droit international pénal » (Paris, Pedone, 2000), dirigé par les professeurs Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet (p. 269) :
Ainsi, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pénalisation des violations des règles du jus in bello, c'est-à-dire la définition des crimes de guerre et des pénalités qui s'y rattachent, est laissée à l'Etat belligérant et à son droit interne (bien que cette compétence ne puisse être exercée que par référence et dans les limites des règles du jus in bello, et que son exercice soit parfois en exécution d'une obligation conventionnelle). Un saut qualitatif intervient quand le droit international définit directement les crimes de guerre et ne laisse plus cette définition au droit interne des Etats ».
(Les auteurs enchaînent ensuite en faisant partir ce « saut qualitatif » du procès de Nuremberg)
12. Avant de conclure sur le droit et la pratique antérieurs aux événements en cause dans la présente affaire, rappelons que malheureusement les nombreuses atrocités commises, en particulier au cours des deux guerres mondiales, dans l'ensemble n'ont nullement été poursuivies et réprimées avant que, précisément, les choses ne changent avec Nuremberg. Ceci confirme l'avis, cité ci-dessus, de M. et Mme Abi Saab.
13. En ce qui concerne « Nuremberg » (le Statut, le procès et les principes), rappelons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un processus postérieur aux faits de plus d'un an. L'Accord de Londres qui a créé le Tribunal militaire international date du 8 août 1945. Le Statut du Tribunal, annexé à l'Accord, lui a donné compétence pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis certains crimes, notamment des crimes de guerre. L'article 6 b) du Statut donne, pour la première fois, une définition juridique des crimes de guerre, et l'on a vu plus haut, au paragraphe 6 de la présente opinion, que les juridictions nationales ont considéré ces dispositions comme s'appliquant au requérant. Le jugement du Tribunal affirme que la qualification de tels crimes ne résulte pas seulement de cet article, mais aussi du droit international préexistant (notamment les Conventions de La Haye de 1907 et de Genève de 1929) ; toutefois, on peut se poser la question de savoir si la portée de cette phrase déclaratoire, clairement rétroactive, doit être entendue pour le passé erga omnes, ou au contraire être limitée à la compétence d'ensemble ratione personae du Tribunal, ou même à sa compétence quant aux seules personnes jugées par lui lors du procès. Cette question est cruciale, car si le requérant a bien été poursuivi pour des actes qu'il aurait commis ou dont il aurait été complice, il est clair que ce n'était pas pour le compte des « pays européens de l'Axe », contre lesquels il combattait. Si on exclut la possibilité de l'application extensive et par analogie de dispositions pénales, il est difficile d'accepter sans réticences la base juridique tirée des « principes de Nuremberg ».
14. Historiquement, comme le note encore dans son opinion précitée le juge Myjer, c'est donc le procès de Nuremberg « qui, pour la première fois, a bien montré au monde extérieur que quiconque commettrait des crimes analogues à l'avenir pourrait être tenu pour personnellement responsable ». C'est par suite après les faits de la cause que le droit international nous semble avoir réglé le jus in bello avec suffisamment de précision. Que le procès de Nuremberg ait puni ex post facto les accusés traduits devant lui ne veut pas dire que tous les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale pouvaient relever rétroactivement, aux fins de l'article 7 § 2 de la Convention, de l'incrimination de crimes de guerre et des pénalités y afférentes. Les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » ont été, à notre avis, énoncés clairement à Nuremberg, et pas avant. Sauf à postuler par principe qu'ils préexistaient. S'ils préexistaient, à partir de quand ? De la Seconde Guerre mondiale ? De la Première ? De la Guerre de Sécession et du Code Lieber ? N'est-il pas, avec tout le respect, quelque peu spéculatif de l'établir dans un arrêt rendu au début du XXIe siècle ? La question mérite d'être posée.
15. A plus forte raison, ni les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ni la Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre de novembre 1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ne semblent pouvoir donner rétroactivement une base légale aux poursuites engagées en 1998 contre le requérant, alors surtout que selon le droit national la prescription était acquise depuis 1954 (paragraphe 18 ci-dessous).
16. Nous concluons de tous ces éléments que, à l'époque des faits, ni le droit national ni le droit international n'étaient suffisamment clairs en ce qui concerne les crimes de guerre, ou quant à la distinction entre crimes de guerre et crimes de droit commun, si graves que ceux-ci aient pu être. Et certainement les actes commis le 27 mai 1944 (quels que fussent leurs auteurs et/ou complices) ont revêtu une extrême gravité si on s'en rapporte aux faits tels qu'ils ont été établis par les juridictions internes.
17. Peu clair, le droit applicable était-il, par ailleurs, et peut-être subsidiairement, toujours en vigueur, ou y avait-il prescription, s'opposant à ce que des poursuites puissent être engagées contre le requérant pour crimes de guerre, et a fortiori à ce qu'il puisse être condamné sur la base de ces poursuites ?
18. A notre avis, l'action publique était prescrite depuis 1954, selon le droit national en vigueur, car le code pénal de 1926 prévoyait en matière criminelle une prescription de dix ans depuis la commission de l'infraction. Ce n'est que depuis la loi du 6 avril 1993 – près de 50 ans après les faits – que le code pénal (de 1961) a été amendé et a édicté l'imprescriptibilité à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables de crimes de guerre. Nous pensons que c'est donc par une application rétroactive du droit pénal que cette imprescriptibilité a été appliquée au requérant, ce qui n'est normalement, à nos yeux, pas compatible avec l'article 7.
19. La majorité estime certes (paragraphes 232 et 233 de l'arrêt) qu'aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international en 1944 pour les crimes de guerre. Mais d'une part, comme nous l'avons dit, nous considérons que les faits ne pouvaient être qualifiés en 1944 de crimes de guerre faute de base légale suffisamment claire et précise, d'autre part ces faits étaient prescrits dès 1954. Nous ne sommes donc pas convaincus par ce raisonnement, qui implique en somme que l'imprescriptibilité en matière pénale est la règle et la prescription l'exception, alors que, nous semble-t-il, cela devrait être l'inverse. Il est clair que l'imprescriptibilité des crimes les plus graves est un progrès, car il fait reculer l'impunité et permet le châtiment. La justice pénale internationale s'est fortement développée, en particulier depuis la création des tribunaux internationaux ad hoc puis de la Cour pénale internationale. Mais il est difficile de décider ex post facto une imprescriptibilité sans texte clair qui la fonde.
20. Se pose enfin, et peut-être surtout, la question de la prévisibilité, en 1944, de poursuites engagées en 1998, sur la base d'un texte de 1993, pour des faits commis en 1944. Le requérant pouvait-il prévoir à cette époque que, plus d'un demi-siècle plus tard, les faits pourraient être qualifiés par un tribunal de manière à fonder sa condamnation, et pour un crime imprescriptible ?
21. Nous ne saurions entrer dans le débat sur la prévisibilité des changements historiques et juridiques postérieurs et parfois très postérieurs aux faits (procès de Nuremberg, Conventions de Genève de 1949, Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968, loi de 1993 adoptée après la restauration en 1991 de l'indépendance de la Lettonie). Bornons nous à rappeler que c'est sur la base du droit international que le requérant a été condamné. A cet égard, l'analogie faite par l'arrêt (paragraphe 236) à l'affaire K.-H.W. c. Allemagne ([GC], no 37201/97, CEDH 2001-II) ne nous semble pas non plus décisive. Il s'agissait de faits survenus en 1972, punissables selon la législation nationale applicable à l'époque de ces faits, et la Cour a considéré qu'il fallait en outre les apprécier selon le droit international : mais celui existant en 1972 et non en 1944. De même, dans l'arrêt Korbely c. Hongrie ([GC], no 9174/02, 19 septembre 2008), les faits, survenus en 1956, étaient en tout cas postérieurs, notamment, aux Conventions de Genève de 1949.
22. Au total, nous rappelons qu'il ne s'agit pas de rejuger le requérant, de déterminer sa responsabilité individuelle, en tant qu'auteur, dirigeant ou complice, ou de confirmer ou d'infirmer l'appréciation des faits à laquelle se sont livrées les juridictions nationales. Il ne s'agit pas non plus de minimiser la gravité des actes perpétrés le 27 mai 1944 à Mazie Bati. Ce qui est en cause, c'est l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition n'est pas anodine ; elle est très importante, comme le montre en particulier le fait que l'article 7 est non dérogeable en vertu de l'article 15 de la Convention.
23. Nous estimons finalement, au regard de l'article 7, que :
a) la base juridique des poursuites engagées contre le requérant et de sa condamnation n'était pas suffisamment claire en 1944 ;
b) qu'elle n'était pas non plus raisonnablement prévisible à cette époque, en particulier par le requérant lui-même ;
c) que les faits étaient en outre prescrits dès 1954 selon le droit interne applicable ;
d) et par suite que c'est par une application rétroactive du droit pénal au détriment du requérant que ces faits ont été considérés comme imprescriptibles, ce qui a fondé sa condamnation.
Pour toutes ces raisons, l'article 7 a été, à notre avis, violé.
Note de Frédéric Fabre: Dire que le droit coutumier international et que la Convention d'Amsterdam de 1907 n'étaient suffisamment pas précis et prévisibles pour empêcher les crimes de guerre de la seconde guerre mondiale, est reconnaitre à contrario l'illégalité des procès de Tokyo et de Nuremberg dont la compétence est fondée sur les mêmes textes. Il est évident que lorsqu'un soldat brûle vive une civile enceinte, il sait ce qu'il fait ! En fait le requérant se pensait définitivement à l'abri au sein du régime soviétique, pour ne pas être poursuivi.
Quand un texte prévoit une prescription, il fixe le délai et par conséquent l'évoque. En l'absence de référence, il n'y a pas de prescription. Les conventions internationales ultérieures n'ont fait que préciser ce choix.
CET ARRET EST CONFIRME PAR UNE DECISION D'IRRECEVABILITE
DECISION D'IRRECEVABILITE VAN ANRAAT C. PAYS BAS DU 20 JUILLET 2010 REQUÊTE 65389/09
Le requérant a été condamné pour avoir fourni des produits chimiques nécessaires à la fabrication du gaz moutarde à Sadam Hussein en Irak
Homme d’affaires, Adrianus van Anraat acheta puis fournit d’avril 1984 à août 1988 au gouvernement irakien plus de 1 100 tonnes de thiodiglycol, un produit chimique utilisé pour produire le gaz moutarde. Après 1984, il fut le seul fournisseur de ce produit au gouvernement irakien.
On sait que le gaz moutarde fut utilisé par l’armée irakienne contre l’armée iranienne et des civils iraniens durant la guerre Iran-Irak (1980-1988) et lors d’attaques menées contre la population kurde vivant dans le Nord de l’Irak. L’une de ces attaques, dirigée contre la ville d’Halabja en mars 1988, fit des milliers de victimes et des milliers de blessés parmi la population civile. Saddam Hussein, président de l’Irak de 1979 à 2003, et Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikriti, secrétaire général du parti Baas pour le Nord de l’Irak de 1987 à 1989, surnommé « Ali le Chimique », furent plus tard considérés comme les principaux responsables.
M. van Anraat fut traduit en justice aux Pays-Bas pour avoir fourni à l’Irak des produits chimiques, dont du thiodiglycol, ainsi que des matériaux et conseils en vue de la fabrication d’armes chimiques, au mépris du droit international. L’acte d’accusation citait plusieurs dispositions du droit interne, dont l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre (« l’article 8 »).
Le requérant fut condamné par la cour d’appel des Pays-Bas pour avoir été le complice de crimes de guerre interdits par l’article 8, à savoir des violations des « lois et coutumes de la guerre » commises par Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid al-Tikriti et d’autres dans a) un conflit international ou non international pour ce qui est des attaques au gaz contre la population kurde à Halabja et dans d’autres endroits du Nord de l’Irak et b) dans un conflit international pour ce qui est des attaques au gaz contre l’Iran et les zones de l’Irak jouxtant la frontière avec l’Iran. La cour d’appel définit les « lois et coutumes de la guerre » comme les dispositions du droit international coutumier interdisant notamment l’utilisation d’armes chimiques ou d’armes toxiques, l’utilisation de gaz asphyxiants ou toxiques, l’infliction de souffrances non nécessaires et les attaques visant les civils et les combattants de manière indiscriminée. Elle s’appuya sur le Protocole de Genève de 1925 sur l’emploi des gaz et les quatre Conventions de Genève de 1949. M. van Anraat fut condamné à une peine d’emprisonnement de 17 ans.
Le requérant forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
Le procureur général près la Cour suprême soumit un avis consultatif auquel M. van Anraat répondit avec un nouvel argument, à savoir que Saddam Hussein et Ali Hassan al-Majid al-Tikriti étant protégés par le principe de l’immunité souveraine en leur qualité de membres du gouvernement d’un Etat souverain et ne relevant donc pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être jugé pour complicité avec ces personnes.
Le 30 juin 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Cour suprême n’avait pas répondu à son argument selon lequel, Saddam Hussein et Ali Hassan al-Majid al-Tikriti ne relevant pas de la compétence des juridictions néerlandaises, il n’aurait pas dû être condamné comme complice de ces personnes. Sur le terrain de l’article 6 ou de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, il dénonçait aussi le fait que l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre, se référant au droit international, ne respectait pas l’exigence selon laquelle les actes criminels devaient être décrits avec suffisamment de précision (lex certa).
Article 6
Compétence des juridictions néerlandaises
La Cour relève que l’argument de M. van Anraat relatif à l’immunité souveraine ne figurait pas parmi ses moyens d’appel mais a été invoqué pour la première fois dans sa réponse écrite à l’avis consultatif du procureur général, lors de la phase finale de la procédure précédant l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême. Le respect du caractère contradictoire d’une procédure n’exige pas qu’un défendeur soit autorisé à présenter de nouveaux arguments n’ayant aucune incidence sur un des points contenus dans l’avis consultatif. En l’occurrence, le requérant ayant fait usage de la possibilité de présenter un argument entièrement nouveau au tout dernier stade de la procédure, la Cour suprême n’était pas tenue de fournir une réponse motivée aux fins de l’article 6 § 1
Par ailleurs, si M. van Anraat avait souhaité que la Cour suprême réexamine ou précise sa jurisprudence, rien ne l’empêchait de soulever la question plus tôt.
La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.
Article 7
Sécurité juridique
Le requérant fait valoir que la Cour suprême n’aurait pas dû juger que le caractère vague de l’article 8 est « inévitable », que les « coutumes de la guerre » sont des termes trop généraux et imprécis et que le Protocole de 1925 ne reflète plus la réalité de la guerre contemporaine. Il argue que l’usage par l’Irak de gaz moutarde comme arme de guerre ne saurait être perçu comme moralement ou juridiquement différent de l’usage du napalm (une arme incendiaire) par l’armée américaine au Vietnam, et revêt un caractère insignifiant par rapport à la possession d’armes nucléaires par un petit nombre d’Etats et le recours à de telles armes en 1945. Selon lui, dans ces conditions, on ne pouvait attendre de lui qu’il se rende compte à l’époque de la guerre Iran-Irak que ses activités commerciales étaient illégales.
La Cour rappelle que les armes incendiaires et nucléaires relèvent de régimes distincts sans rapport avec l’affaire en cause. La comparaison effectuée par M. van Anraat entre le gaz moutarde, d’une part, et le napalm et les armes nucléaires, d’autre part, n’est donc pas pertinente pour examiner la présente requête. La Cour ne peut que se prononcer sur le point de savoir si le requérant a été condamné pour des actes qui constituaient « une infraction d’après le droit national ou international » à l’époque où ils ont été commis.
La Cour observe qu’à l’époque où le requérant a fourni du thiodiglycol au gouvernement irakien, une norme du droit international coutumier interdisait l’utilisation de gaz moutarde comme arme de guerre dans les conflits internationaux.
Lorsque le requérant a commis les actes qui lui ont valu d’être poursuivi, il n’y avait aucune ambiguïté quant à la nature criminelle de l’utilisation du gaz moutarde, que ce soit contre un ennemi dans un conflit international ou contre la population civile présente dans les zones frontalières touchées par un conflit international. On pouvait donc raisonnablement attendre du requérant qu’il connaisse l’état du droit et, si nécessaire, s’entoure de conseils.
La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.
Note de Frédéric Fabre, l'argumentation de la CEDH sur l'article 6 est inopérante puisque le requérant avait soutenu une incompétence d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure. En revanche comme il est néerlandais, les juridictions de son pays sont compétentes pour le juger pour crime de guerre puisqu'il est lui même un national. Si j'arrive à la même conclusion que la Cour c'est donc par une motivation beaucoup plus pertinente.
L'argumentation sur l'article 7 est donc pertinente puisque les méfaits du gaz moutarde sont dénoncés depuis le début du XXième siècle.
 CONCERNANT LA SUISSE
CONCERNANT LA SUISSE
Il n'y a pas de condamnation pour violation de l'article 7 de la Convention.
 CONCERNANT LA BELGIQUE
CONCERNANT LA BELGIQUE
Voir les arrêts précités ci-dessus
 CONCERNANT LE LUXEMBOURG
CONCERNANT LE LUXEMBOURG
Il n'y a pas de condamnation pour violation de l'article 7 de la Convention.
 CONCERNANT LA FRANCE
CONCERNANT LA FRANCE
Arrêt Jamil contre France du 25 mai 1995 Hudoc 511 15917/89
Le Gouvernement ne reconnaissait pas un caractère pénal à une contrainte par corps appliqué par l'effet rétroactif d'une loi postérieure. La C.E.D.H a constaté la violation de l'article 7 de la Convention:
"Prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la sanction infligée à Monsieur Jamil pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif. Elle constituait donc une peine au sens de l'article 7§1 de la Convention.
§35 Nul ne conteste, en l'espèce, le caractère rétroactif de l'application de ladite loi relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants"
Arrêt Cantoni contre France du 15 novembre 1996 Hudoc 656 requête 17862/91
Le requérant considérait que les articles L511 et suivants du Code de la santé publique ne permettait de prévoir précisément la définition juridique d'un médicament.
En conséquence, quand il a ouvert un rayon parapharmacie dans son supermarché, l'imprévisibilité de la loi ne lui permettait pas de savoir s'il engageait ou non sa responsabilité pénale.
La C.E.D.H applique les principes dégagés dans l'arrêt Coeme et autres contre Belgique précité et ne constate pas de violation de l'article 7 de la Convention:
"Le requérant soutenait qu'appliqué notamment au domaine de la parapharmacie, la notion de médicament telle qu'elle ressortissait des textes ayant fondé sa condamnation ne présentait pas une clarté permettant d'identifier avec précision les actes de nature à engager sa responsabilité pénale.
La Cour doit dès lors rechercher si, en l'espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence nationale dont elle s'accompagne, remplissait cette condition à l'époque des faits"
Depuis 1957, bien avant les faits, la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts pour préciser la définition de médicament au sens des articles L511 et suivants du Code de la santé publique:
"Bien avant les faits de la cause, la haute juridiction avait adopté une position claire à ce sujet, laquelle n'allait que s'affermir au fil du temps. A l'aide de conseils appropriés, Monsieur Cantoni, de surcroît Gérant de supermarché, devait savoir, à l'époque des faits, eu égard à la tendance se dégageant de la jurisprudence de la Cour de Cassation et d'une partie des jurisprudences du fond, il courait un danger réel de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie"
Arrêt Radio France du 30 mars 2004 Hudoc 4987 requête 53984/00
la Cour constate qu'en droit interne, l'article 93-3 de la loi 82-652 prévoit en matière de fausse information, une responsabilité du directeur de l'information en cas de "fixation préalable" avant diffusion et un désengagement de sa responsabilité en cas de diffusion "directe":
"§20: Vu le principe de fonctionnement de France Info, il était destiné à être régulièrement répété sur l'antenne, en direct, à intervalles réguliers. En l'absence de "fixation préalable", les juridictions répressives ont exonéré le directeur de publication de toute responsabilité au titre du premier des communiqués diffusés sur France Info; elles ont par contre jugé que cette première diffusion constituait une "fixation préalable" du message au regard des diffusions subséquentes; elles ont ainsi retenu que, dès la seconde diffusion, il pourrait être considéré que le directeur de la publication avait été mis en mesure d'en contrôler préalablement le contenu. La Cour estime que, dans le contexte particulier du fonctionnement de France Info, cette interprétation de la notion de "fixation préalable" était cohérente avec la substance de l'infraction en cause et "raisonnablement prévisible". Partant, il n'y a pas violation de l'article 7 de la Convention"
AFFAIRE PESSINO c. FRANCE Requête no 40403/02 du 10 octobre 2006
La rétroactivité de la loi sur les infractions à la construction est sanctionnée.
"18. Le Gouvernement fait observer d’emblée que le requérant ne conteste pas que la construction d’un immeuble en l’absence de permis de construire constitue une infraction, mais seulement la définition de l’infraction telle que donnée par la jurisprudence.
19. Il souligne que la Cour a estimé dans ses arrêts C.R. c. Royaume-Uni et S.W. c. Royaume-Uni (arrêts du 22 novembre 1995, série A no 335-B et 335-C, §§ 34 et 36 respectivement) qu’
« On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. »
20. Il considère que le requérant fait une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1993. Selon lui, elle n’a pas pris position sur la pertinence de l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait jugé que les faits poursuivis, qui étaient de la même nature que ceux pour lesquels le requérant a été condamné, ne constituaient pas une infraction pénale. Celle-ci aurait uniquement constaté que la partie civile n’était pas habilitée à former ce pourvoi au sens de l’article 575 du code de procédure pénale qui dispose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public, sauf dans certains cas énumérés limitativement.
21. Le Gouvernement est dès lors d’avis que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en rejetant son pourvoi en cassation. Il ajoute que la base de données « Légifrance » ne présente pas cet arrêt comme un revirement de jurisprudence mais invite à rapprocher cet arrêt d’un précédent du 4 novembre 1998 (voir ci-dessus).
22. En conclusion, le Gouvernement estime que les faits reprochés au requérant constituaient bien, une infraction au moment où ils ont été commis, conformément aux articles L 421-1, L 480-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l’urbanisme et à l’interprétation donnée par la Cour de cassation. Dès lors, le grief du requérant n’est pas fondé.
23. Le requérant conteste l’interprétation que le Gouvernement fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1993. Il souligne que celle-ci a indiqué dans son arrêt que :
« les énonciations de l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue à la suite de l’information à laquelle le juge d’instruction a procédé sur la plainte des parties civiles, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits, objet de cette information, a, répondant au mémoire des parties civiles, énoncé les motifs pour lesquels elle estimait que les faits poursuivis ne constituaient pas une infraction pénale ».
Il estime qu’elle ne l’aurait pas fait si elle n’avait pas approuvé, au fond, l’analyse de la cour d’appel.
24. Il souligne que le Gouvernement ne peut produire aucune décision, notamment de la Cour de cassation, antérieure à son affaire et concluant que le fait de poursuivre des travaux de construction malgré un sursis à exécution du permis de construire émis par le juge administratif constitue une infraction pénale, car il n’en existe pas.
25. Il estime donc que l’article 7 de la Convention a été violé dans la mesure où, à la date de l’opération litigieuse, le droit pénal français n’incriminait pas la construction sur le fondement d’un permis ayant fait l’objet d’une décision de sursis à exécution.
26. Le requérant se réfère quant à lui à la décision Enkelmann c. Suisse de la Commission du 4 mars 1985 (D.R. 41, p.178) qui se lit notamment :
« La Commission a admis d’autre part, que le juge pouvait préciser les éléments constitutifs d’une infraction mais non les modifier, de manière substantielle, au détriment de l’accusé. Elle a reconnu qu’il n’y avait rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l’infraction soient précisés et adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle de l’infraction. En revanche, il est exclu qu’un acte qui n’était pas jusqu’alors punissable se voie attribuer par les tribunaux un caractère pénal ou que la définition d’infractions existantes soit élargie de façon à englober des faits qui ne constituaient pas jusqu’alors une infraction pénale. »
27. Il estime que la règle posée par la Chambre criminelle n’était pas raisonnablement prévisible, au point que le commentaire qui en a été fait par un article de doctrine paru dans la « revue de droit pénal » en septembre 2002 indique que « l’arrêt rapporté renverse [la jurisprudence antérieure] par une sèche affirmation que ne soutient aucun raisonnement juridique ».
28. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1627, § 29 et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, 29 mars 2006).
29. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
30. La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145 et Achour c. France [GC], précité, § 43).
31. La Cour a déjà constaté qu’en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L’une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d’autres, Kokkinakis, précité § 40 et Cantoni, précité §31).
La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne.
32. La Cour doit dès lors rechercher si, en l’espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, remplissait cette condition à l’époque des faits (Cantoni précité, § 32).
33. Elle rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, par. 68). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 71, § 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Cantoni, précité, §35).
34. La Cour constate qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas été en mesure de produire des décisions des juridictions internes, que ce soit de la Cour de cassation ou de juridictions du fond, établissant qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il a été jugé explicitement que le fait de poursuivre des travaux de construction, malgré un sursis à exécution émis par le juge administratif à l’encontre du permis de construire, constituait une infraction pénale.
35. En outre, l’analyse des textes du code de l’urbanisme reproduits ci-dessus semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécution d’un permis à construire ne saurait être, en ce qui concerne ses conséquences pénales, clairement assimilable à une « décision judiciaire ou arrêté ordonnant l’interruption des travaux », en vertu notamment de l’article L 480-3 de ce code.
Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle-même pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle également que le principe de la légalité des délits et des peines, contenu dans l’article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété extensivement au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir par exemple Coëme et autres c. Belgique, CEDH 2000-VII, § 145).
Il en résulte que, faute au minimum d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible, les exigences de l’article 7 ne sauraient être regardées comme respectées à l’égard d’un accusé. Or le manque de jurisprudence préalable en ce qui concerne l’assimilation entre sursis à exécution du permis et interdiction de construire résulte en l’espèce de l’absence de précédents topiques fournis par le Gouvernement en ce sens.
36. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale (a contrario Cantoni c. France, précité, § 35 et Coëme et autres c. Belgique, précité, § 150).
A cet égard, la Cour considère que la présente affaire se distingue clairement des arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni (paragraphe 19 ci-dessus), dans lesquelles il s’agissait d’ un viol et d’une tentative de viol de deux hommes sur leurs femmes. La Cour avait pris soin de noter dans ces arrêts (§§ 44 et 42, respectivement) le caractère par essence avilissant du viol, si manifeste que la qualification pénale de ces actes, commis par des maris sur leurs épouses, devait être regardée comme prévisible et non contraire à l’article 7 de la Convention, à la lumière des objectifs fondamentaux de celle-ci, "dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines".
37. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 7 de la Convention."
A découvrir aussi
- Absence de diffamation non publique en présence d’un écrit litigieux à caractère confidentiel
- Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant a un déni de justice
- Le conflit d'intérêts Définition